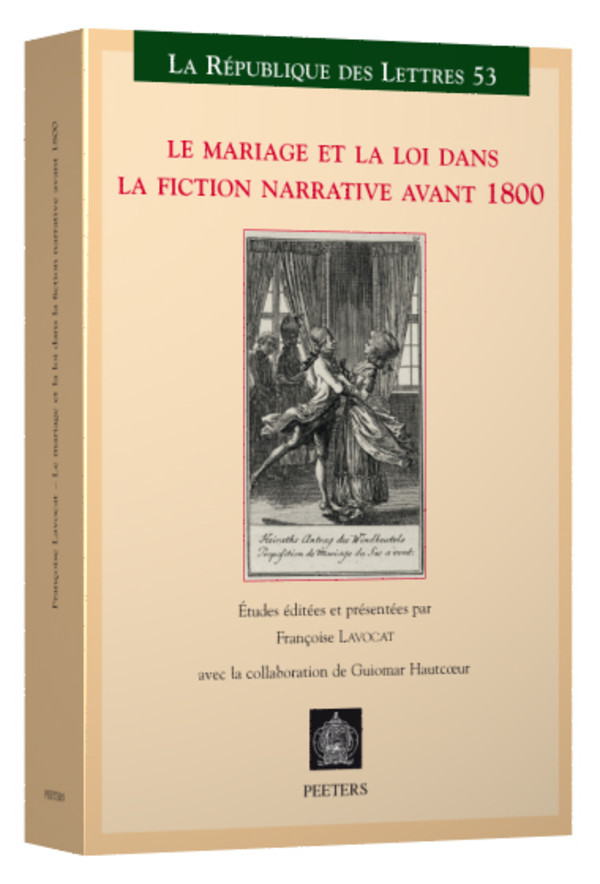
Le mariage et la loi dans la fiction narrative avant 1800
Paru en mars 2014
Peeters - La République des Lettres
Disponible
Prix : 76,00 €
Acheter
770 pages - 16 × 24 cm
ISBN 978-90-429-2675-2 - mars 2014
Présentation
« Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ». Le mariage est, par excellence, la conclusion obligée des contes de fées, des romans sentimentaux et des films hollywoodiens. Mais qu’en est-il dans d’autres genres, ou lorsque le mariage intervient au début de la nouvelle ou au cœur du roman? Est-il alors condamné, de façon également stéréotypée, à être défait? S’il est vrai que les « toutes les familles heureuses se ressemblent », comme l’écrit Tolstoï au début d’Anna Karénine, le bonheur matrimonial semble incompatible avec l’intérêt romanesque. Tel est le moindre paradoxe du mariage comme topos, heureux ou malheureux selon sa place dans le récit.
La production narrative européenne, du moyen-âge à la fin du dix-huitième siècle, offre un éventail extrêmement riche et diversifié de situations récurrentes (en d’autres termes de topoï) concernant le mariage. Or, dans la même période, le mariage est une institution et un sacrement en débat. A partir du seizième siècle, de nouvelles lois, l’affirmation des droits de la subjectivité et des individus, en particulier des femmes, les guerres civiles et religieuses, la découverte d’autres peuples et de coutumes étrangères éveillent la réflexion et nourrissent les controverses. Comment s’articulent alors l’ordre du récit, les normes internes et externes à la fiction, et la perception du mariage comme problème?