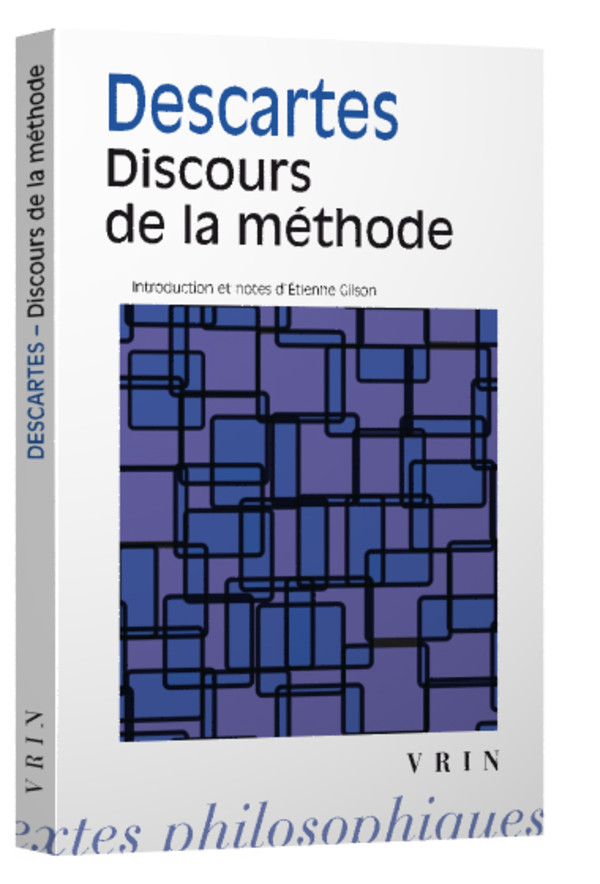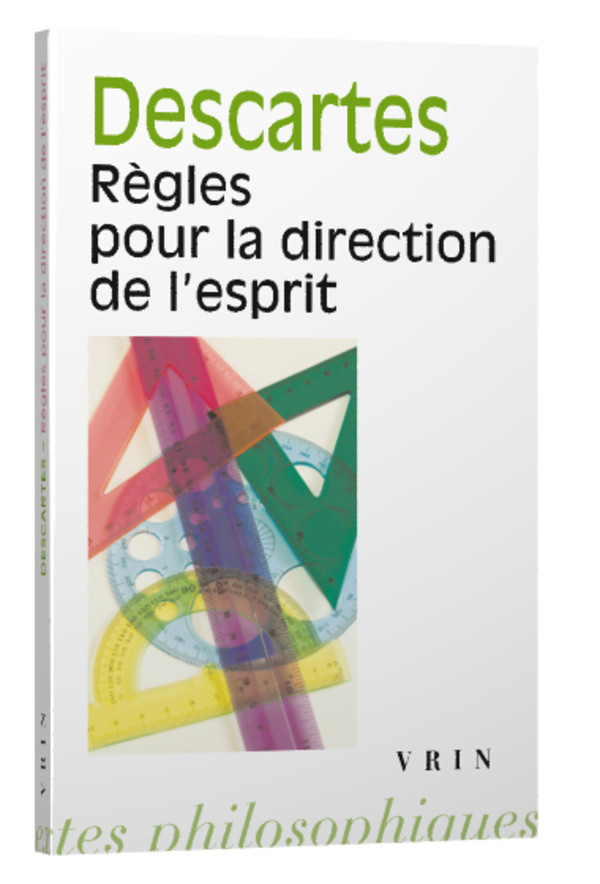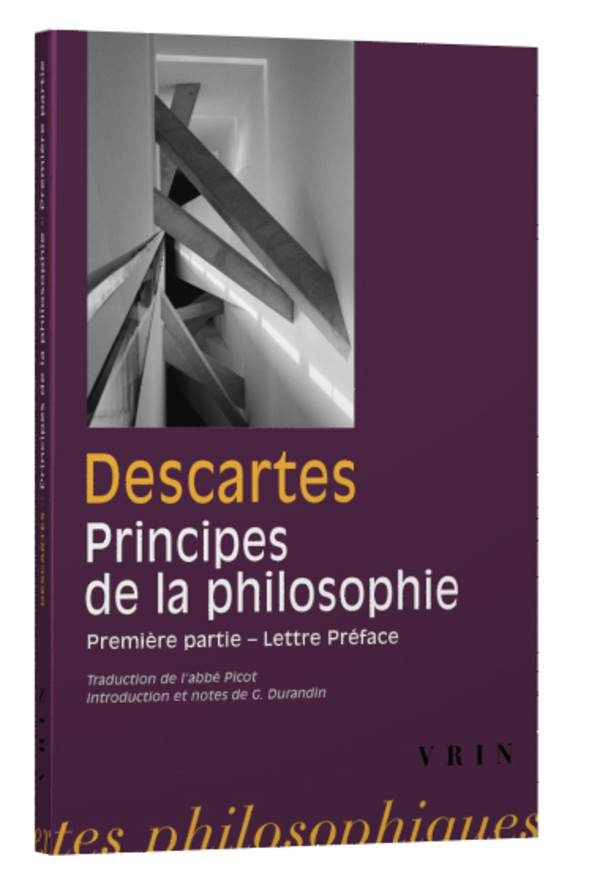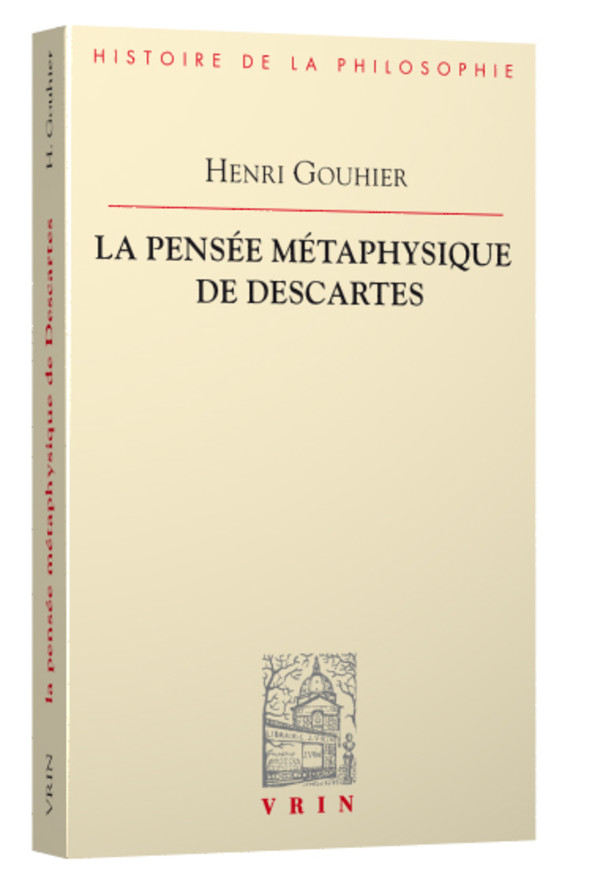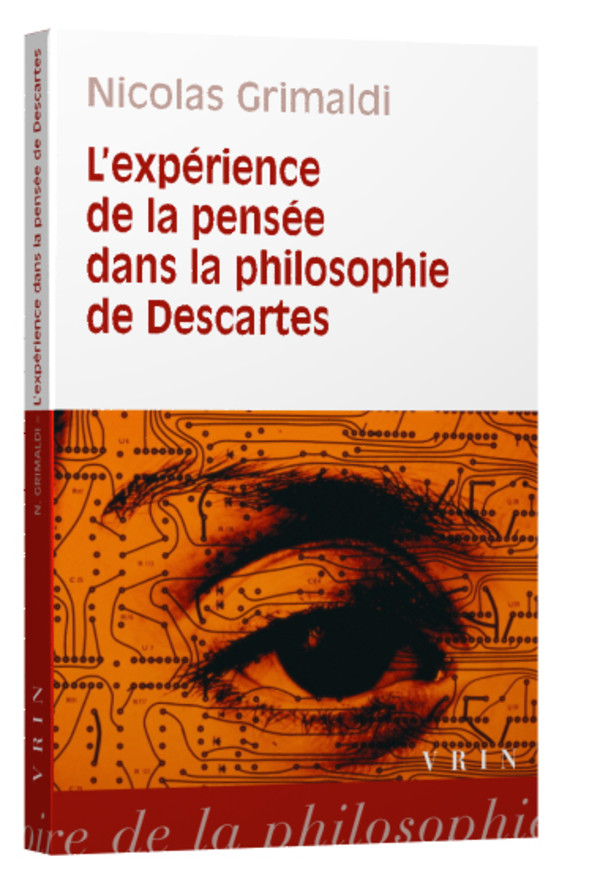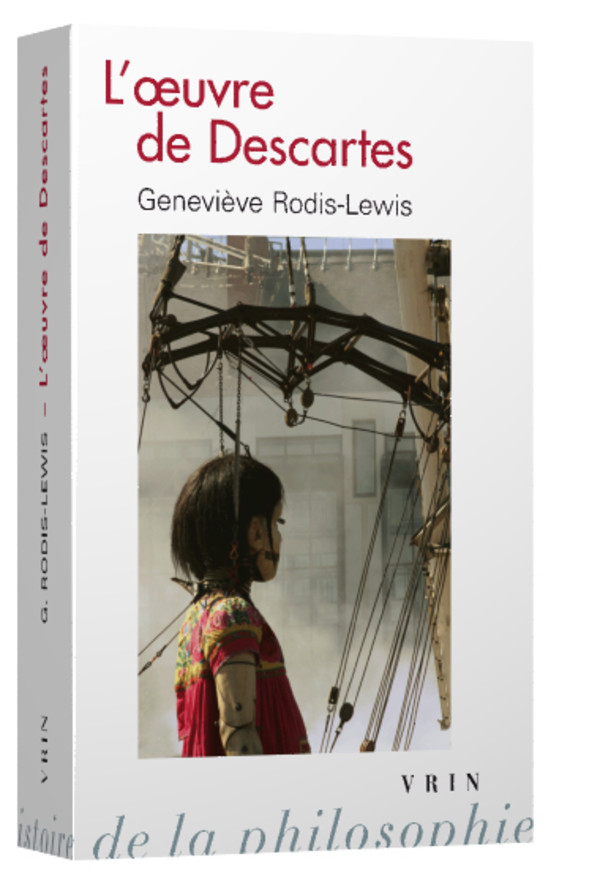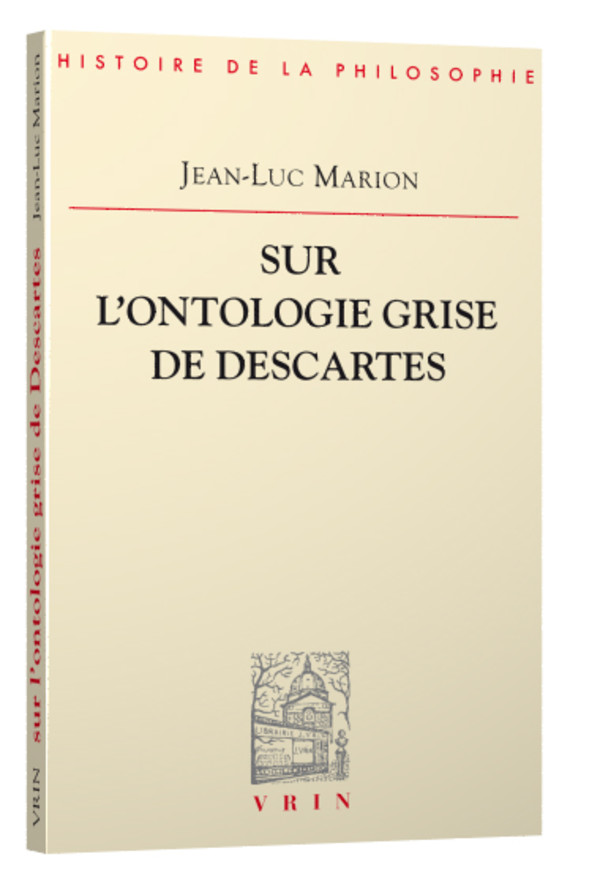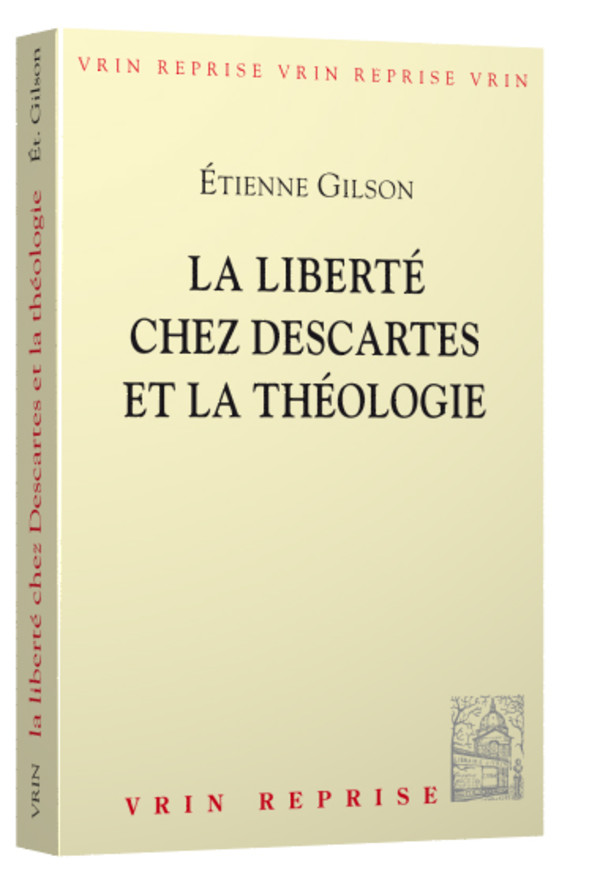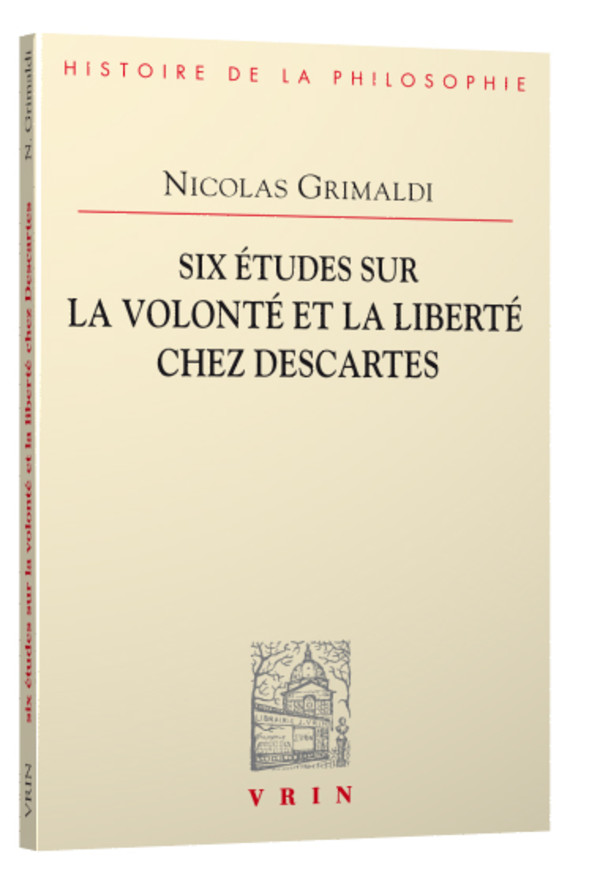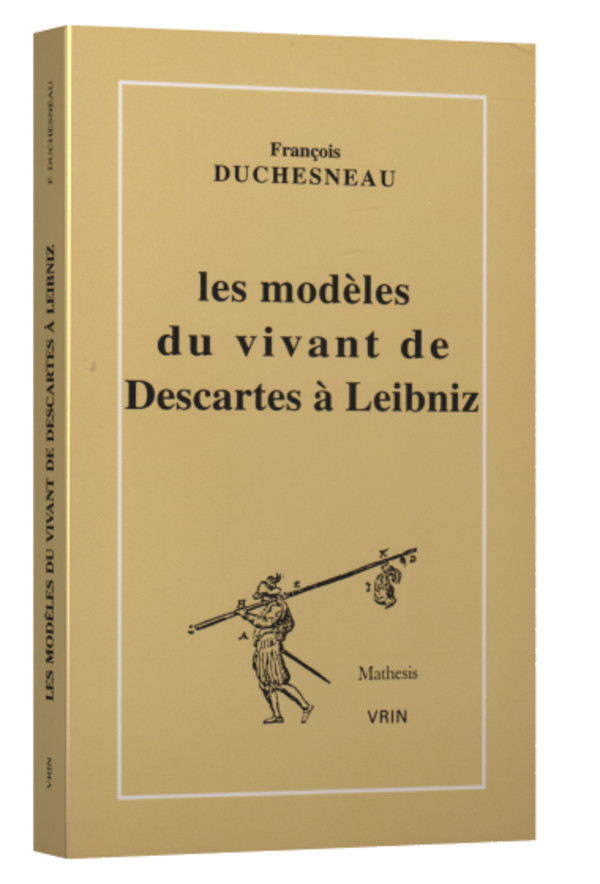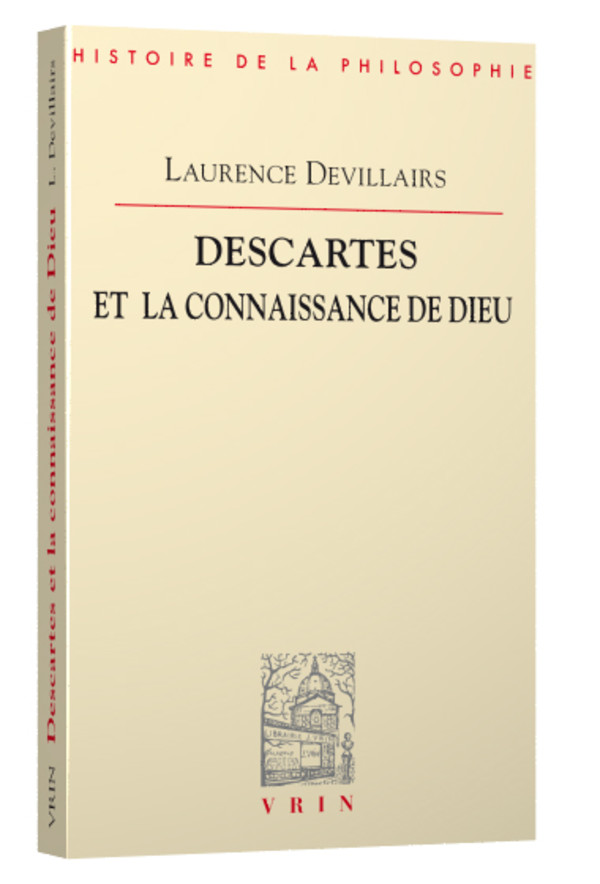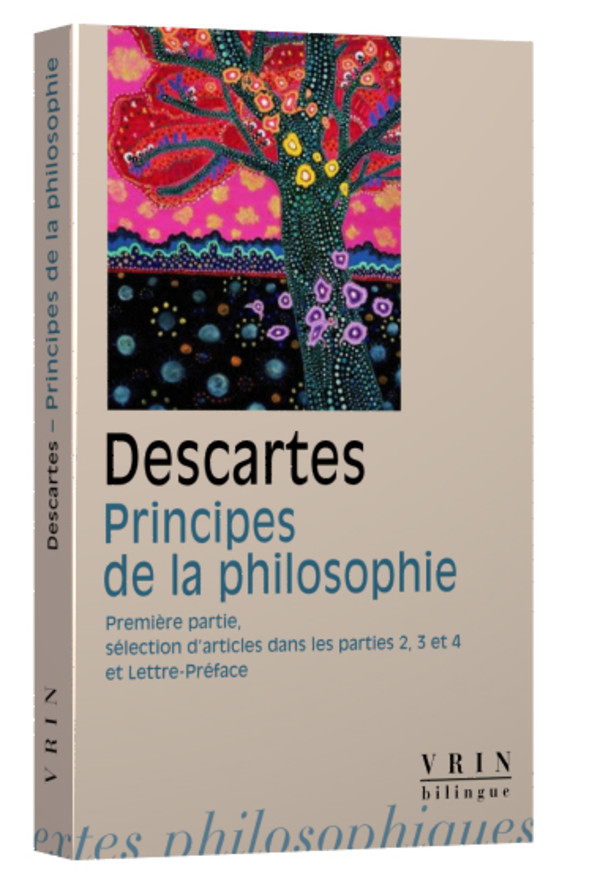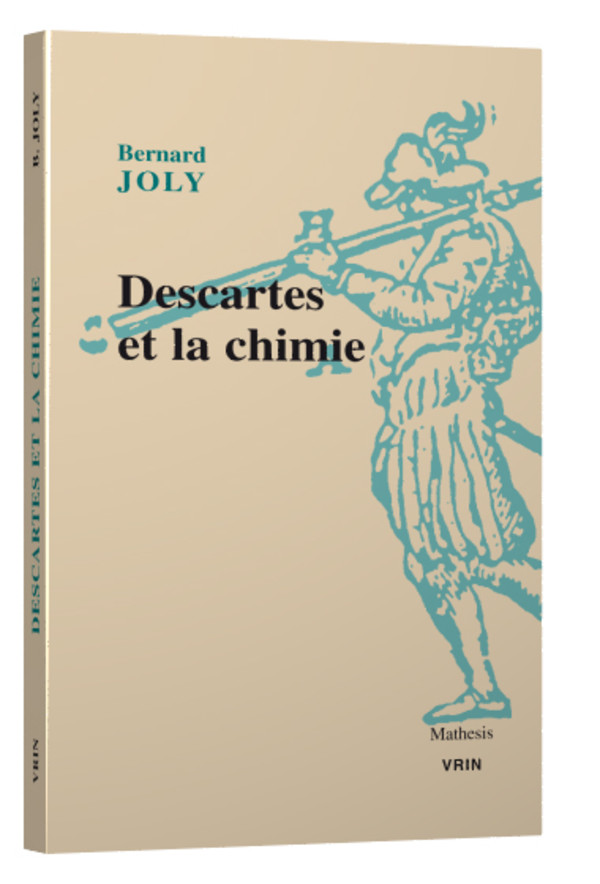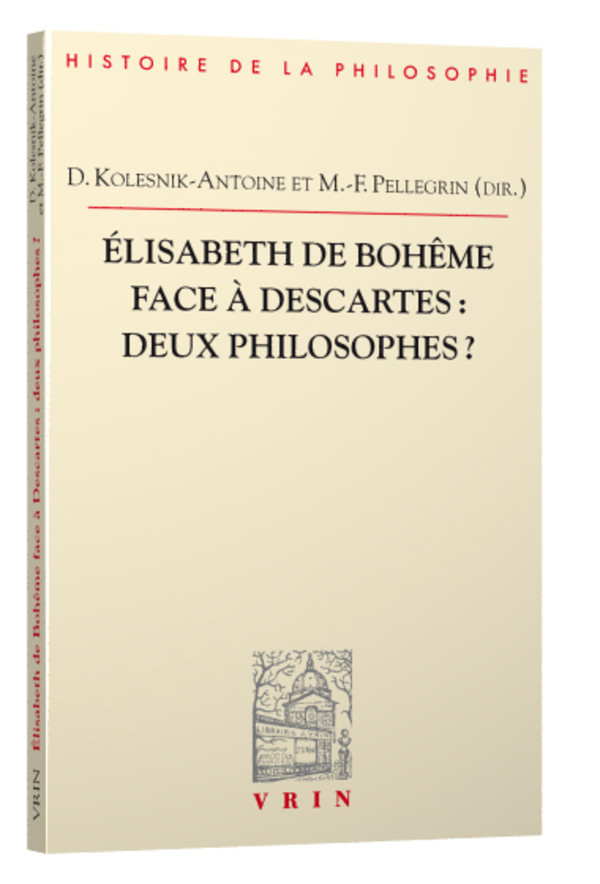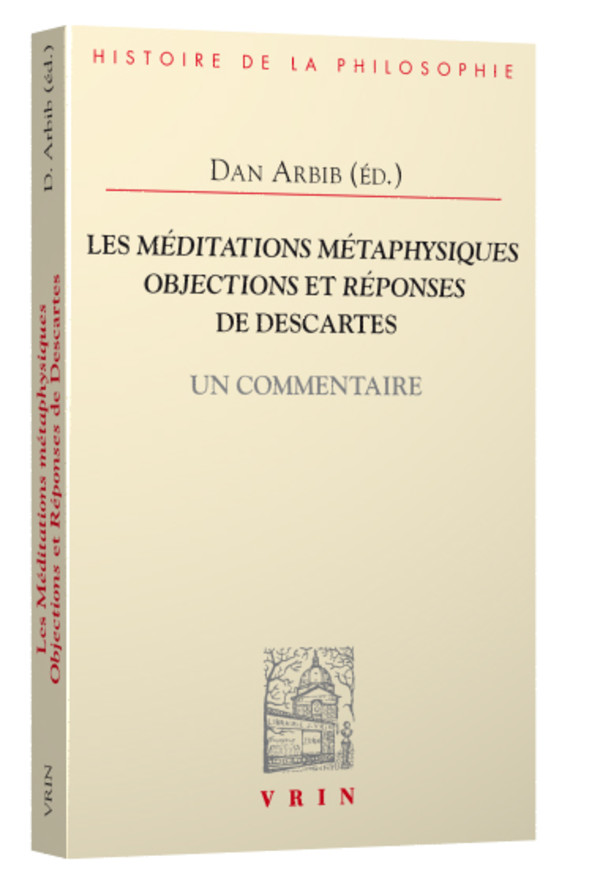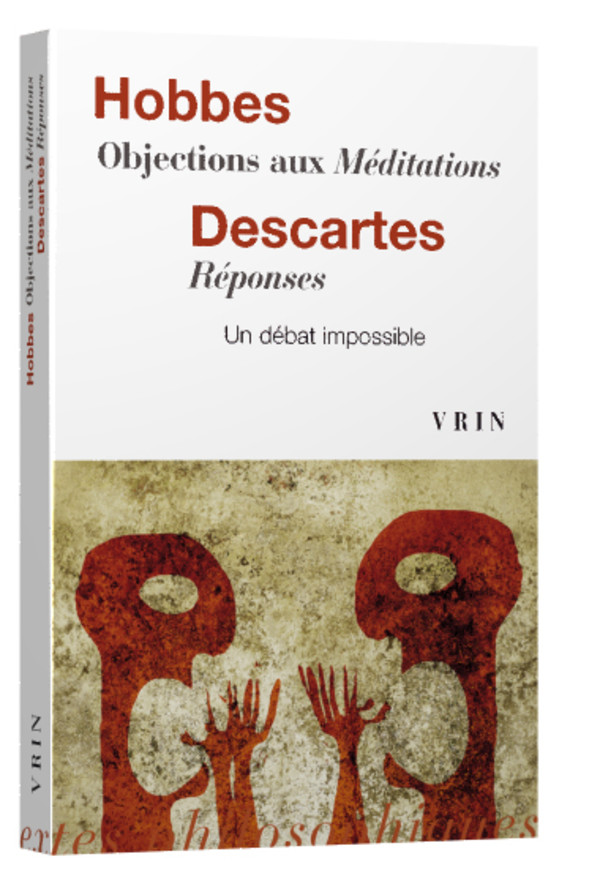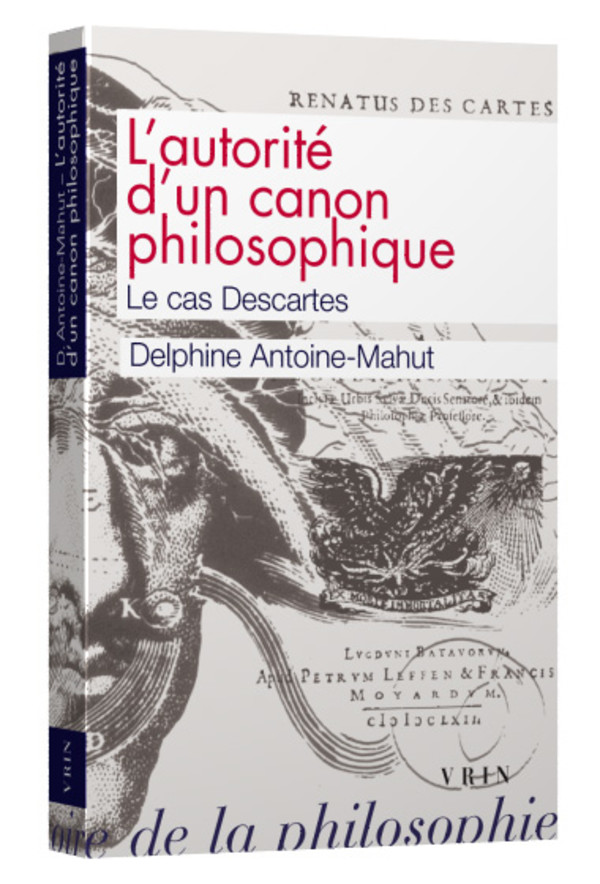L’autorité d'un canon philosophique, entretien avec Delphine Antoine-Mahut
03 septembre 2021
Delphine Antoine-Mahut, vous parlez dès l’introduction de votre livre d’un « problème de Glaucus » qui entourerait le processus de canonisation d’un auteur de philosophie. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ?
La légende raconte que lorsque la statue de Glaucus fut retrouvée après un long séjour au fond de la mer, les traits distinctifs de ce pêcheur de métier, devenu un Dieu, restaient discernables derrière les multiples déformations. Chacun pouvait reconnaître Glaucus. Et pourtant, ce n’était plus complètement lui, ou plus le Glaucus d’origine. Il était à la fois défiguré et immortalisé.
Si cette légende s’avère particulièrement pertinente pour poser la question de la formation du canon, c’est parce qu’elle permet d’expliciter une tension structurante, dans l’état de l’art actuel, entre deux positions-types : l’ « essentialisme » et le « phénoménisme ». L’ « essentialisme » désigne l’injonction à retrouver le « vrai » Glaucus ou à se rapprocher le plus « fidèlement » possible de l’ « original » qui a été dégradé. Le « phénoménalisme » désigne l’intérêt pour les modalités concrètes et les principaux acteurs du façonnage de cette « grandeur », à différents moments de son histoire. La question de l’éventuelle « ressemblance » entre un point de départ et un point d’arrivée s’en trouve du même coup secondarisée.
Le « problème de Glaucus » interroge très précisément l’articulation de ces deux perspectives. On peut le formuler de la façon suivante : comment expliquer à la fois que Glaucus continue d’être reconnu par tous et qu’il diffère de ce que l’on sait, ou croit savoir, du premier état de la statue ? Ou : Comment penser la canonisation comme processus philosophique ?
Vous revenez sur l’identification actuelle, en particulier dans le milieu anglo-saxon, de six « Glaucus » de la période moderne : Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley et Hume. Quels ont été les critères de sélection de ces figures canoniques ? Et pourquoi pas Pascal, Montaigne, Malebranche, ou encore Hobbes ?
La question des critères de sélection est en effet centrale, dans un contexte de débats passionnés et très politisés, qui se sont développés aux Etats-Unis à compter des années soixante et d’abord en littérature, sur la question du canon des Humanités.
La « short list » en question est parfois réduite à deux séries d’initiales : « DSL » ou le camp des « rationalistes », face à « LBH » ou au camp des « empiristes ». Elle est ironiquement désignée par ses détracteurs à l’aide d’une expression française : la « crème de la crème », dans l’objectif de dénoncer la partialité des critères ayant présidé à sa sélection : en termes de problèmes philosophiques (épistémologiques et métaphysiques, la raison plutôt que les passions) ou de supports (des traités plus que des correspondances, ou des ouvrages pour un public lettré plutôt que de la vulgarisation, par exemple). Cette partialité a entraîné une série d’exclusions plus ou moins conscientes, mais redoutablement efficaces. L’enjeu est alors celui du renouvellement du canon pour renouveler en retour le curriculum.
Ces critiques peuvent avoir une valeur heuristique pour réfléchir sur les raisons du difficile droit d’entrée, dans le canon philosophique, de figures « sceptiques » comme Montaigne. Elles attirent notre attention sur l’importance de la diversité des corpus (que l’on songe par exemple à la bigarrure des manuscrits clandestins) ; des médiations institutionnelles et philosophiques dans la constitution de ce canon (les spiritualistes cousiniens, qui ont mis en place pour longtemps en France les programmes de philosophie, ne risquaient pas de donner Hobbes ou Diderot à étudier aux jeunes générations, en tout cas pas autrement que comme des repoussoirs) ; des différences entre les pays (Malebranche étant beaucoup plus spontanément intégré au canon en France qu’ailleurs, par exemple) ; entre disciplines (faut-il étudier Pascal plutôt en philosophie ou en lettres ?). Plus largement, elles problématisent les raisons d’absences manifestes dans ce canon, comme celle des femmes et de cultures non occidentales.
Mais que ce « club des 6 » relève en partie de circonstances que les historiens de la philosophie ne peuvent plus ignorer, ne signifie pas pour autant qu’il soit complètement relatif. Le Glaucus sorti des flots est le résultat d’un processus, dont on a tôt fait d’oublier la genèse plurielle. L’une des thèses centrales de mon ouvrage est ainsi que le travail sur la pluralisation des figures canoniques elles-mêmes est complémentaire du travail sur la pluralisation du canon par l’inclusion d’autres figures.
Vous faites le choix dans votre ouvrage d’étudier le cas de René Descartes, reconnu comme le fondateur de la pensée moderne. En quoi cette figure d’autorité est-elle le paradigme de la formation d’un canon philosophique ?
Il y a plusieurs types de réponses possibles à cette question. J’en retiendrai essentiellement deux.
1/ Dans un de ses articles, le regretté Jean-Marie Beyssade identifie chez Descartes ce qu’il appelle une « procédure de conciliation des énoncés vrais mais divergents ». Une des particularités de Descartes consiste ainsi à reconnaître des types de vérités qui ne peuvent pas être pensés en même temps mais qui doivent chacun être maintenu dans son registre propre. Les deux plus célèbres « conciliations » de ce type sont celle de l’expérience de l’union et de la connaissance évidente de la distinction de l’âme et du corps, d’une part ; de l’expérience certissima et evidentissima de ma liberté et de la connaissance évidente de la toute-puissance divine, d’autre part. Les penser ensemble se contrarie. Et pourtant, aucune ne doit être sacrifiée à l’autre. Les héritiers de Descartes y verront quant à eux un problème. Et ils s’efforceront de hiérarchiser ces vérités voire de choisir l’une plutôt que l’autre. Le canon dualiste est le résultat à la fois gagnant et appauvri de ce processus. On peut ainsi montrer que c’est précisément parce que Descartes ne se réduit pas à sa figure canonique qu’il constitue un support de choix pour réfléchir à la pluralisation du canon des Humanités.
2/ Descartes a très tôt été amené à expliciter ce qu’il considérait comme étant proprement « sien », ou devant être attaché à son nom. Il nous fournit en ce sens de précieux éléments pour identifier et expliciter ce qu’il convient de définir comme « cartésien » si on souhaite lui demeurer « fidèle ». Mais contrairement à ce que le canon rigidifié présente comme exemplaire : les Méditations métaphysiques (surtout les quatre premières) et le Discours de la méthode (surtout les quatre premières parties, là-aussi), ces explicitations décisives apparaissent sous les feux croisés des polémiques et dans des supports à la fois peu étudiés (la correspondance, les Notae in programma…) et ajoutés après-coup (la Lettre-préface aux Principes, par exemple). Elles sont ensuite relayées (justifiées et critiquées) dans une histoire des réceptions mobilisant à son tour des supports très variés. Dans mon ouvrage, j’accorde notamment une grande importance aux travaux éditoriaux et aux manuels et, plus largement, à ces textes centraux pour l’explicitation de la manière dont on souhaite être lu ou faire lire l’œuvre d’un autre, que sont les préfaces. Cette démarche, qui prête attention à la façon dont l’œuvre est donnée à lire, n’est pas naturelle dans notre tradition française, qui considère volontiers que l’œuvre existe dans une sorte d’univers intemporel immatériel. Il nous faut donc travailler à rendre visible cette réalité.
Ce corpus cartésien au sens large fournit en ce sens un matériau de choix pour renouveler nos représentations topiques, non seulement de la philosophie de Descartes (de son contenu, de ses équilibres et des « lieux » où elle s’affirme en se démarquant), mais aussi, plus largement, de ce que l’on considère comme étant, ou non, philosophique.
Vous commencez par analyser la querelle d’Utrecht qui opposa René Descartes au médecin hollandais Henricus Regius, querelle que vous identifiez comme le moment de la « fabrique » du canon cartésien. Pourquoi ce point de départ du vivant même de l’auteur, et en quoi cette opposition a-t-elle durablement marqué l’histoire du canon « Descartes » ?
Il faut distinguer plusieurs niveaux dans cette question.
1/ Pourquoi partir du vivant de l’auteur ? Précisément pour que l’on puisse comprendre pourquoi on reconnaît Glaucus et ce qu’on reconnaît de lui, une fois qu’on l’a sorti des flots. La première étape du processus de canonisation désigne ainsi ce que l’individu, dont le nom été canonisé, a explicitement souhaité qu’on attache à ce nom. Sa façon de se présenter et de se distinguer des autres a alimenté ses représentations futures. Or l’explicitation de ces « intentions » n’est en général ni première, ni univoque. Elle résulte de sélections, de reformulations et de hiérarchisations, par cet individu, dans des circonstances et sous la pression de contraintes données, susceptibles de le défigurer ou de l’amener à se défigurer, d’un ensemble de possibilités initialement indéterminées et dont le devenir philosophique aurait pu être autre, dans sa forme sinon dans son contenu.
2/ Parmi toutes les interactions se traduisant par l’explicitation de ce qui est « propre à soi », la plus difficile et la plus fascinante est celle qui implique celui avec lequel on risque le plus d’être confondu. Or, parmi l’ensemble des autres « noms » dont les études cartésiennes récentes ont repeuplé le canon cartésien, celui du médecin hollandais Henricus Regius (1598-1679) occupe une place absolument singulière. Regius commença en effet par être identifié comme le disciple voire l’ami de Descartes, dans la querelle qui les opposa tous deux aux théologiens aristotéliciens d’Utrecht Voëtius et Schoock. Regius était alors « cartésien » parce qu’il luttait contre la physique aristotélicienne avec les armes de la physique nouvelle de Descartes et que la légitimité de ce combat était reconnue par Descartes lui-même. Mais ensuite, Descartes rompit avec lui, au motif principal que ce dernier voulait étendre la critique des formes substantielles aux idées innées de l’âme et de Dieu et que Descartes ne cautionnait pas cette extension. La relation entre les deux hommes est ainsi un lieu privilégié et sans équivalent pour observer l’évolution d’un ensemble de possibilités cartésiennes initiales et partagées dans deux directions ultérieures scindées.
Le dessin progressif de l’autoportrait de Descartes trouve ainsi son origine dans l’indistinction de la querelle d’Utrecht, qui pousse Descartes à réclamer qu’on l’appelle par son « véritable nom Descartes, plutôt que par cet autre qu’on a forgé, Cartesius » (A Regius, 24 mai 1640). Il se poursuit avec l’ajout de la Lettre-Préface à l’édition française des Principes de la philosophie (1647), après que Regius a publié, contre l’accord de Descartes, des Fundamenta Physices (1646) risquant de passer pour la version officielle et publique de la philosophie cartésienne nouvelle, dont Descartes identifiait la version complète au projet des Principes articulant la métaphysique à la physique. L’image iconique des manuels scolaires, comparant la philosophie à un arbre dont les racines seraient la métaphysique et le tronc, la physique, ne revêt ainsi son sens plein qu’à la lumière de ce souci de démarcation publique avec son alter-ego. Enfin, dans la polémique des Notae in Programma (1647-1648), Descartes répond à un « Placard », attribué à Regius, mettant en cause la démonstration de l’immatérialité de l’âme produite dans les Méditations métaphysiques. Il a alors besoin de s’affirmer, non seulement comme celui qui prouva la distinction de l’âme et du corps, mais, plus encore, comme le premier qui le fit.
3/ Cette opposition entre Descartes et Regius a marqué très durablement l’histoire du canon cartésien, d’abord parce que l’historiographie dominante a relayé le jugement de Descartes sur Regius (la répudiation) en le coupant de sa genèse. Ce faisant, on a oublié que Regius revendiquait un cartésianisme alternatif et plus cohérent que celui de Descartes. On a durci l’opposition qui s’est sédimentée dans le « club des six », entre un « rationalisme » attribué à Descartes et un « empirisme » relégué outre-Manche et commençant avec Bacon et surtout Locke. On a perdu le fil reliant le cartésianisme de Descartes lui-même à des formes variées d’empirisme ; bref, on a perdu l’histoire plurielle et éclectique de cette canonisation. Il est de ce point de vue fort intéressant de suivre l’histoire des réceptions d’un texte encore largement méconnu par les historiens de la philosophie : les Notae in programma quoddam, depuis Tobias Andreae ou Clerselier jusqu’aux articles consacrés au cartésianisme dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ou bien encore, à l’Académie de Berlin, chez Destutt de Tracy, Laromiguière, Degérando ou Cousin.
Pluraliser la figure canonisée de Descartes, c’est ainsi contribuer à problématiser une historiographie dominante encore largement structurée par des antagonismes (entre « Dieux » et « Géants » par exemple) et par des étiquettes rhétoriques (« spiritualiste » et « sensualiste » par exemple) ne trouvant que peu d’ancrage dans l’analyse philologique. C’est contribuer à la réflexion sur l’histoire de la philosophie que nous souhaitons pratiquer et enseigner au XXIe siècle.
Propos recueillis par Émilie Brusson