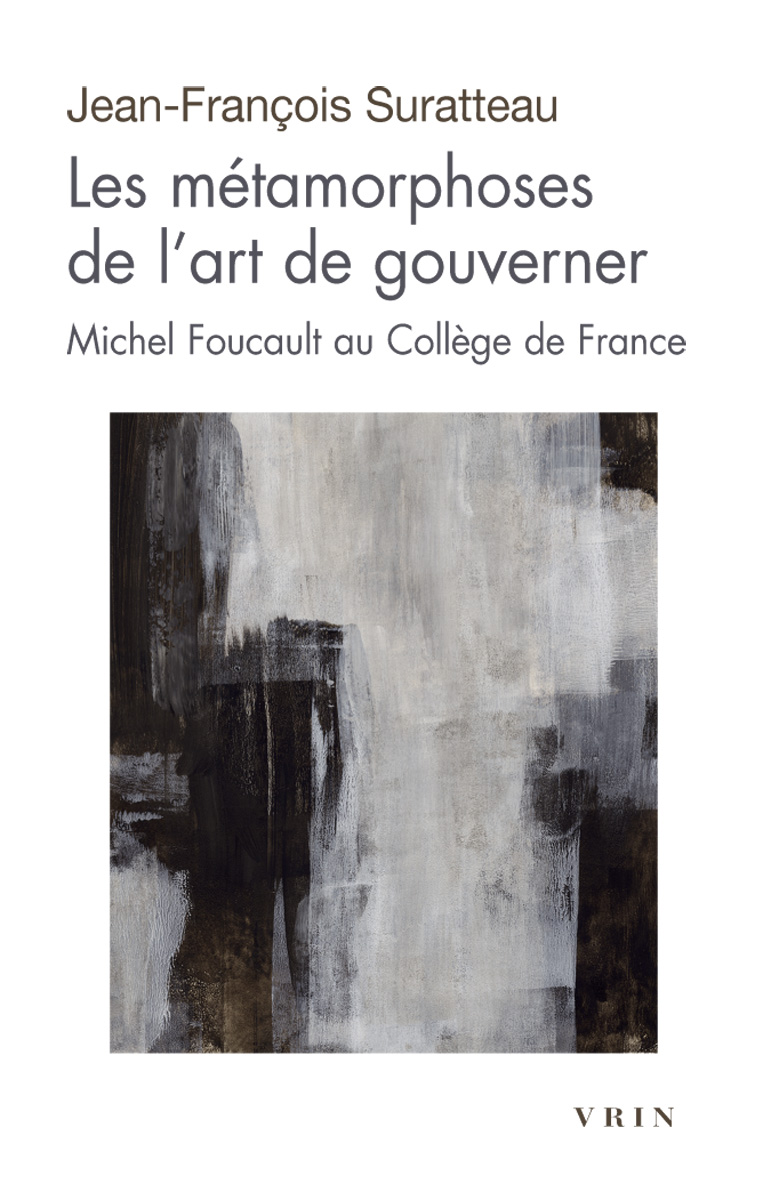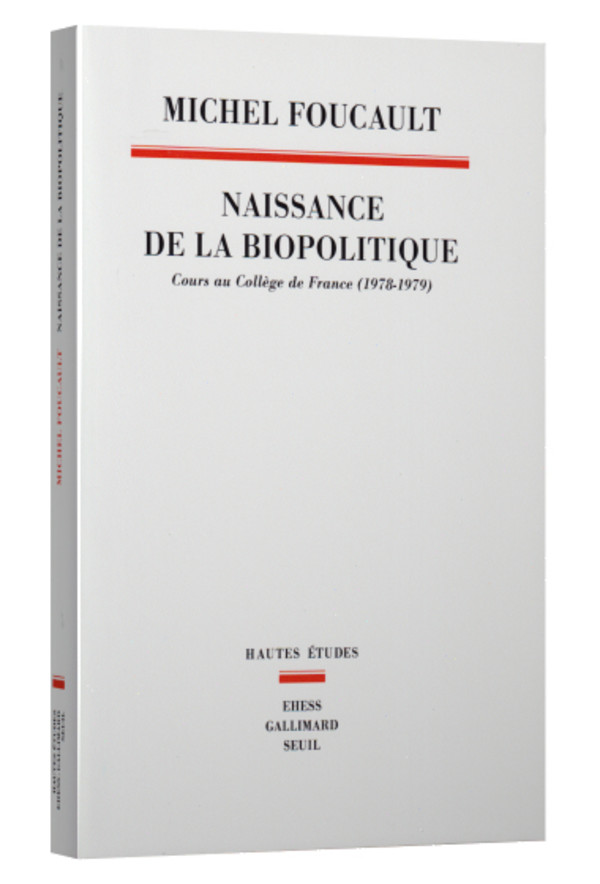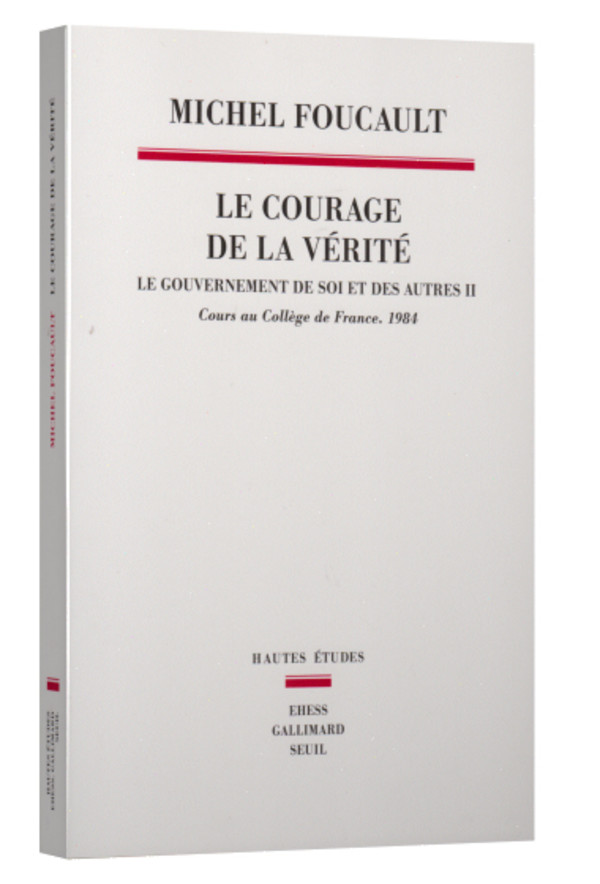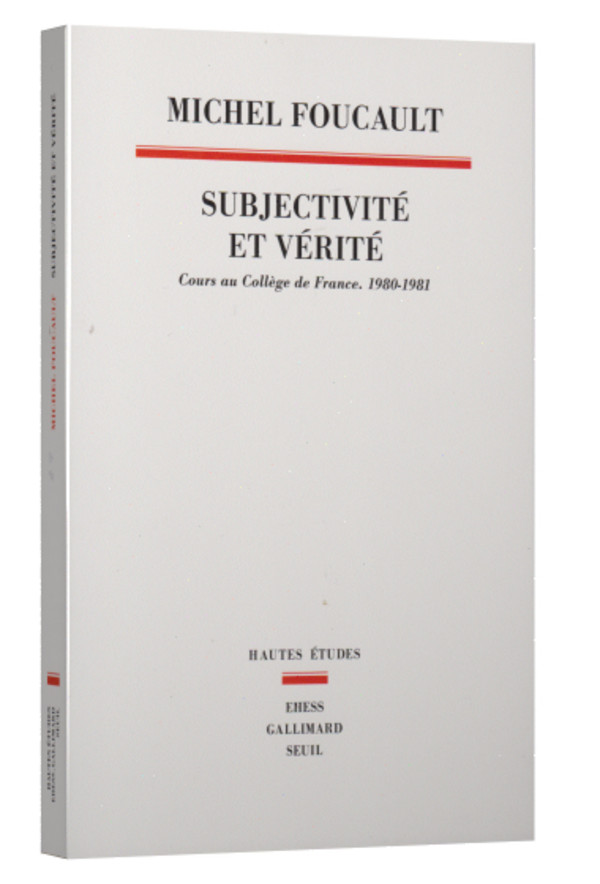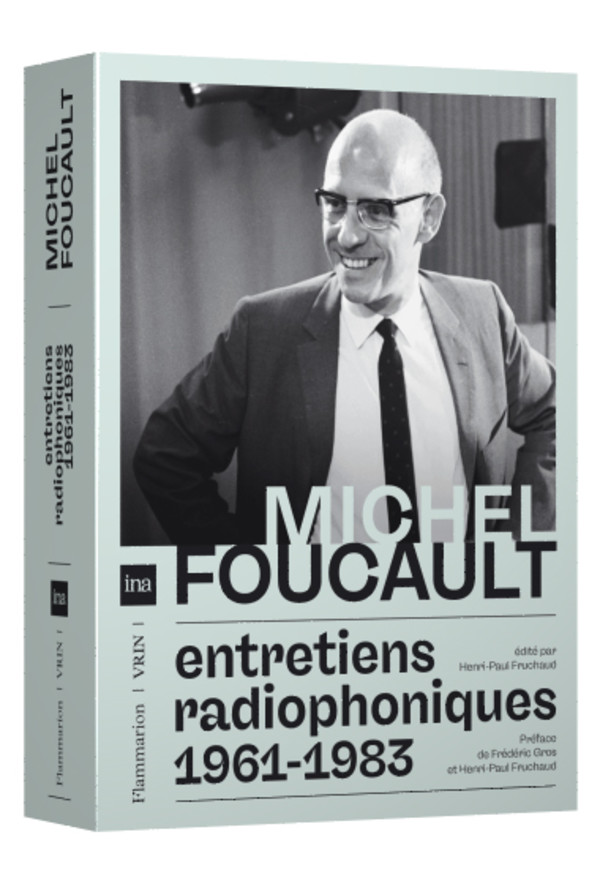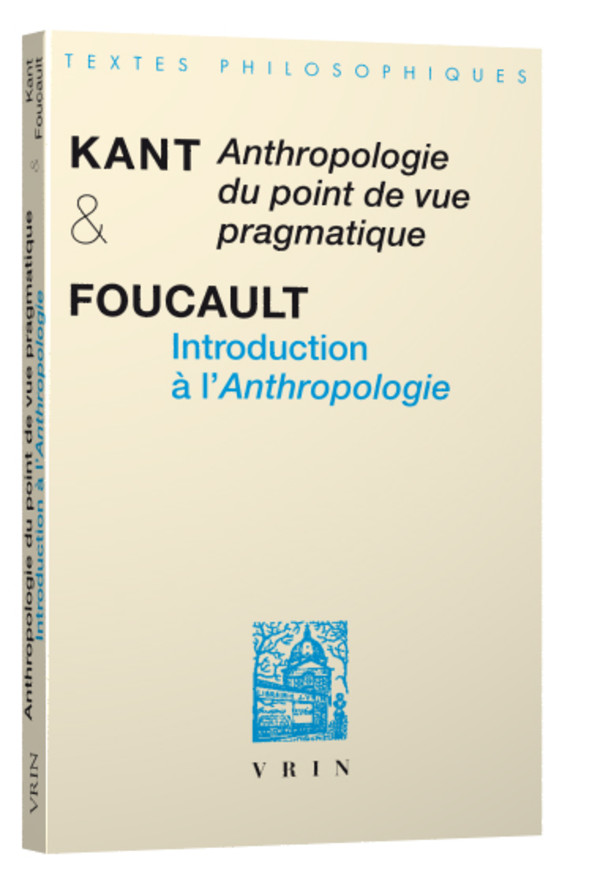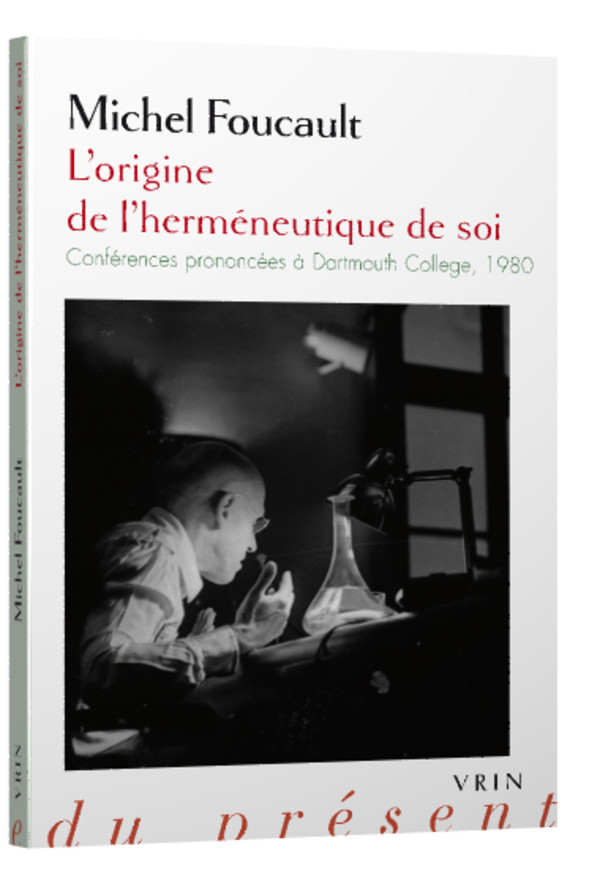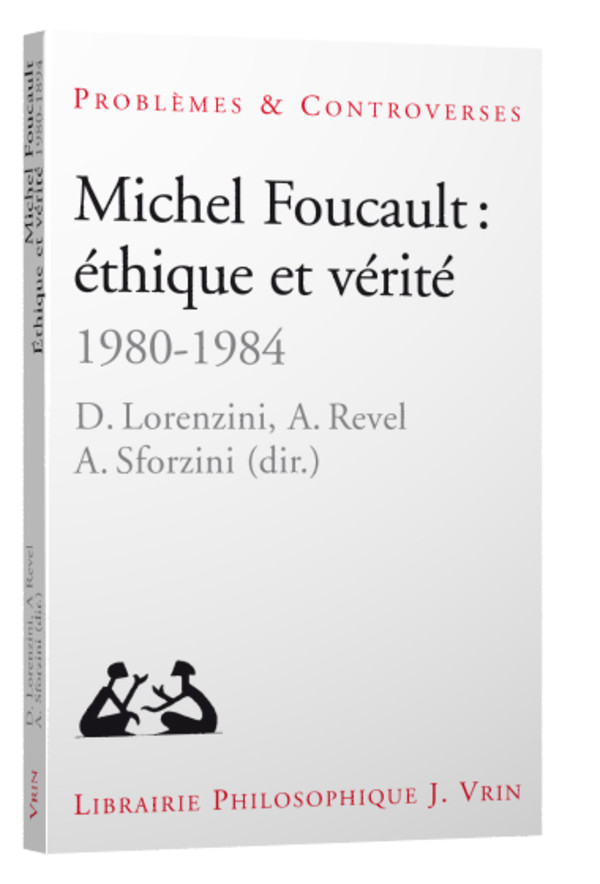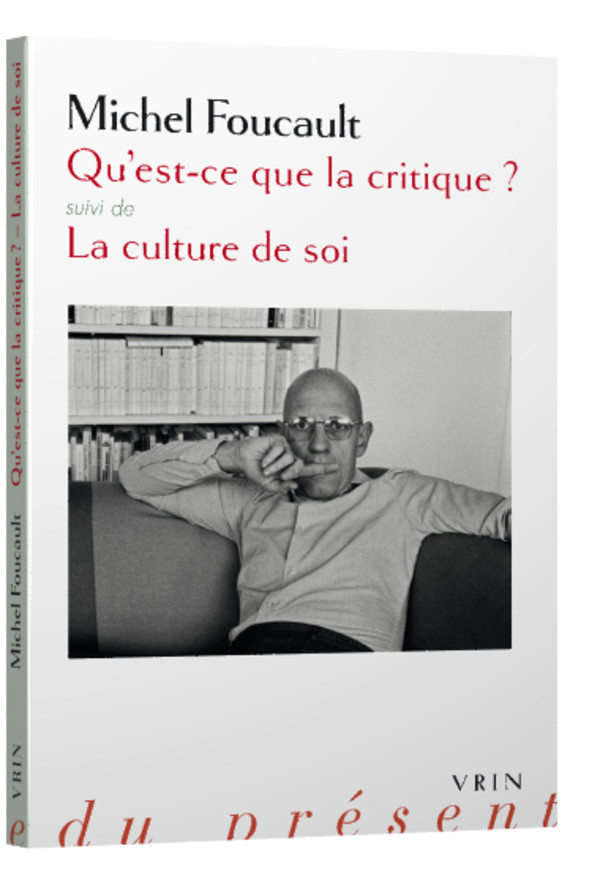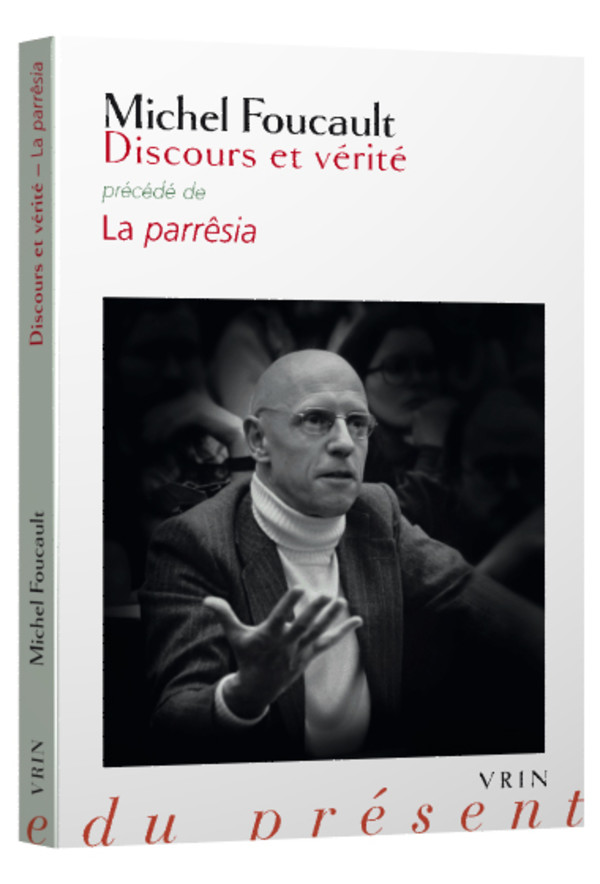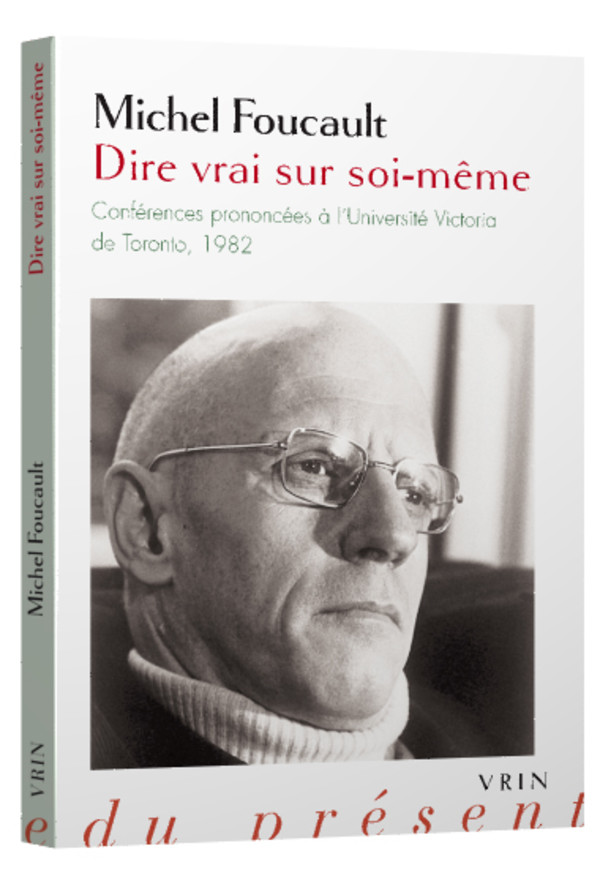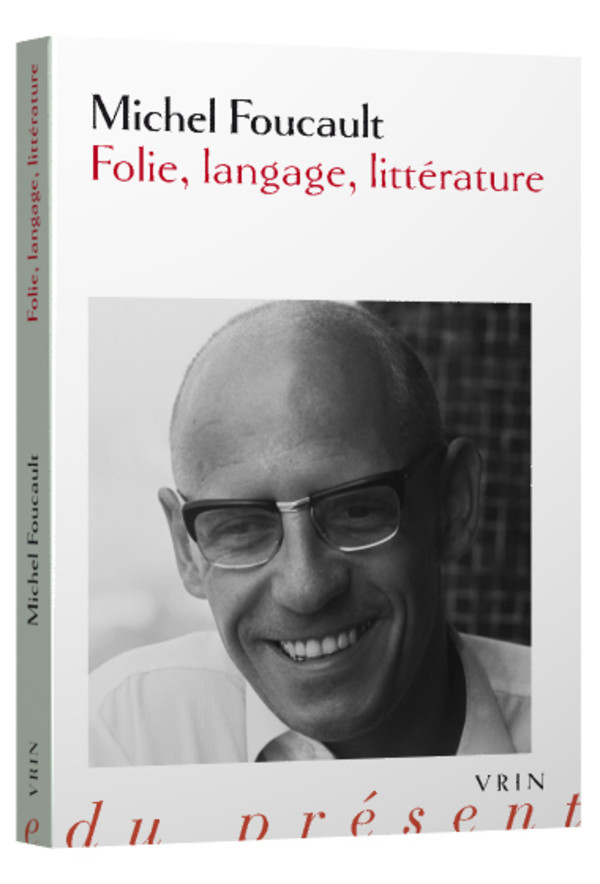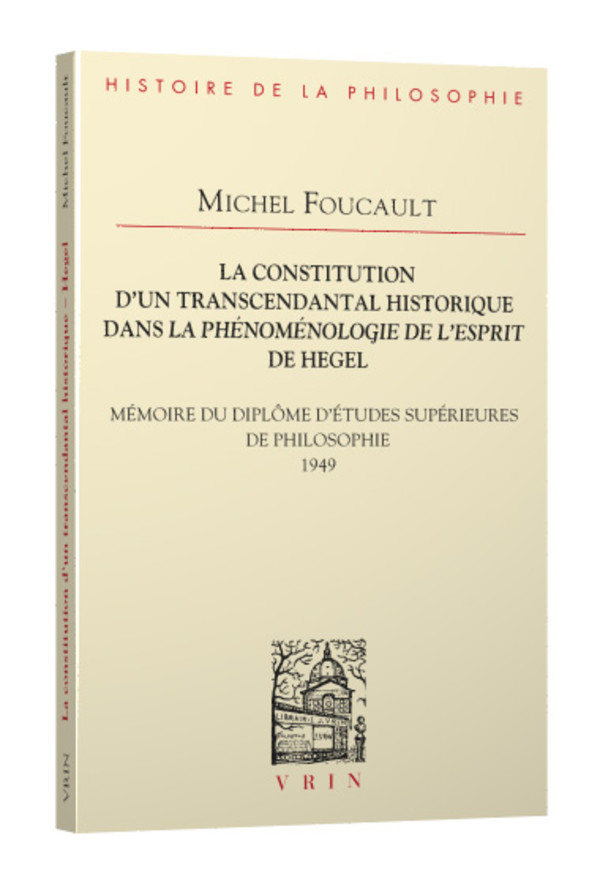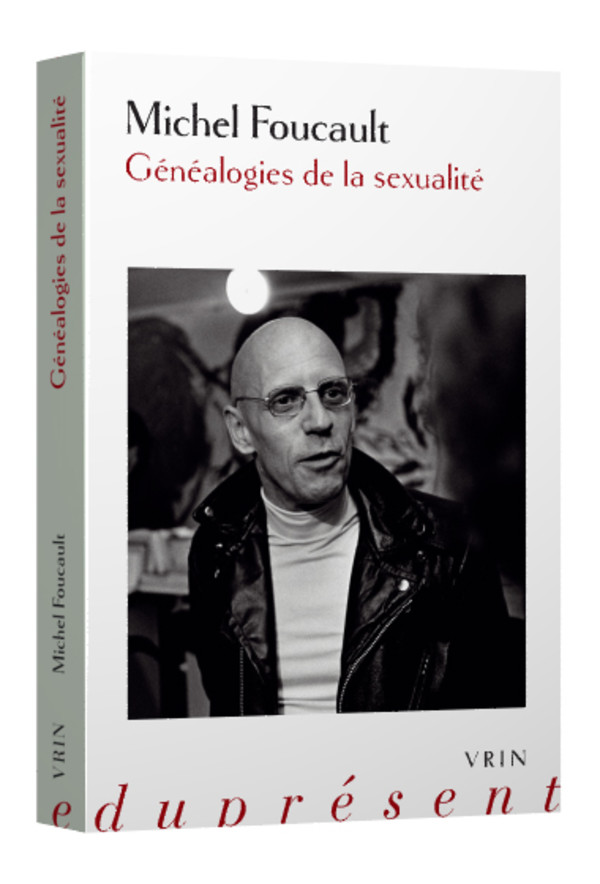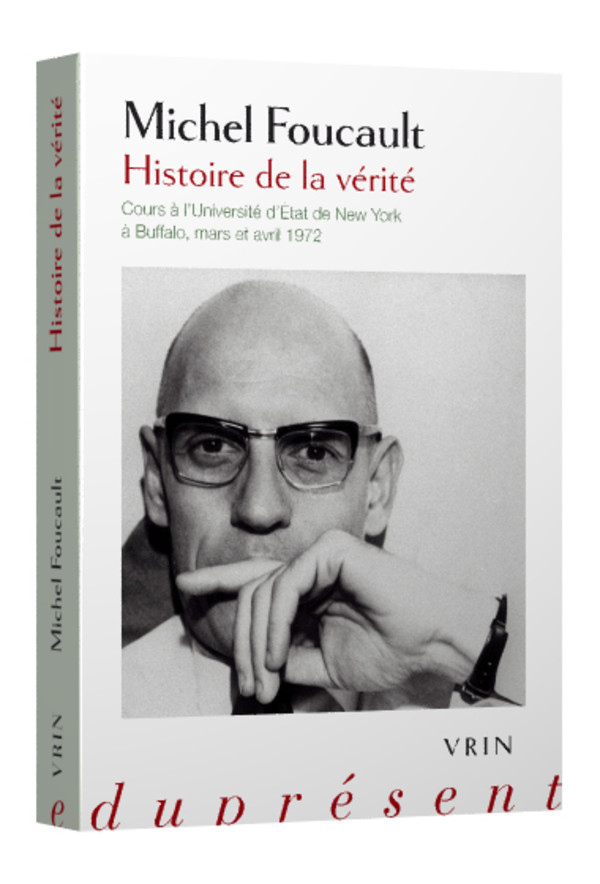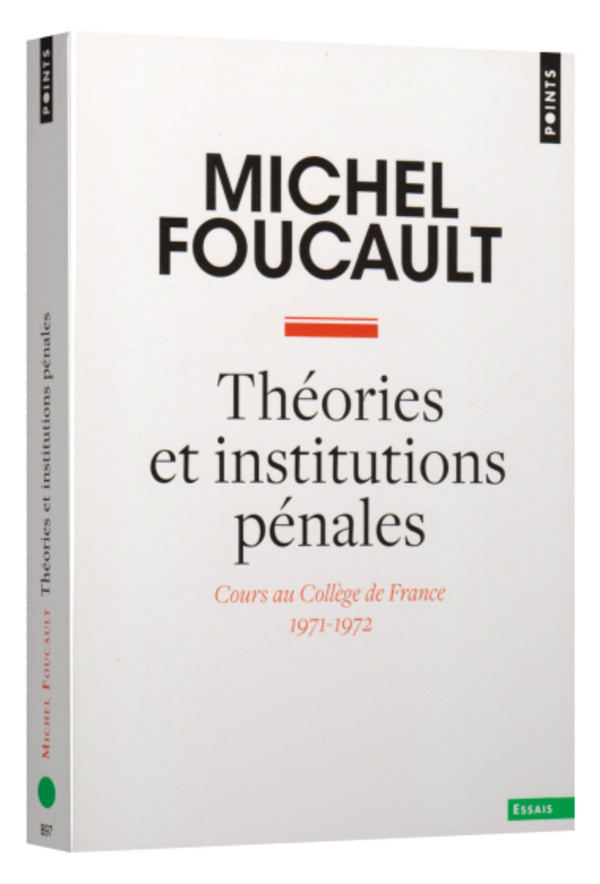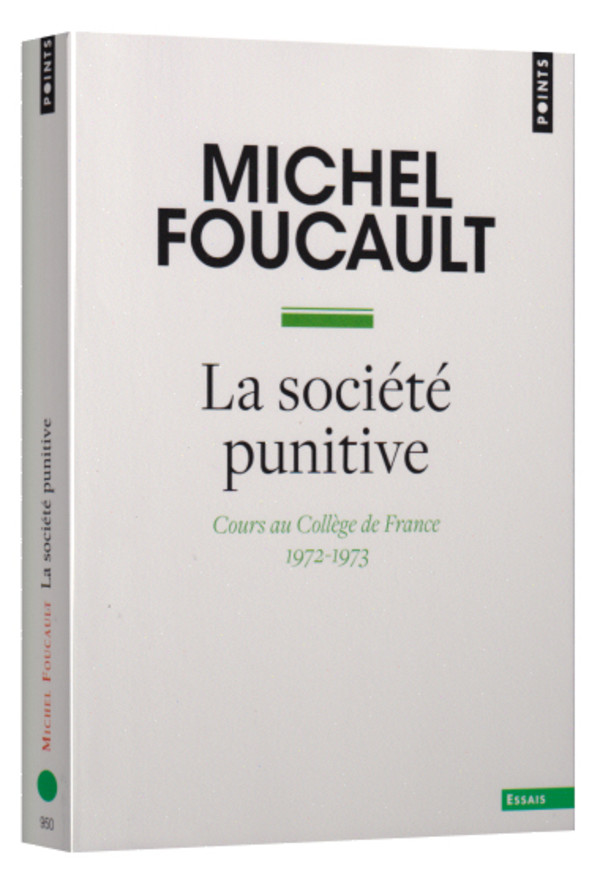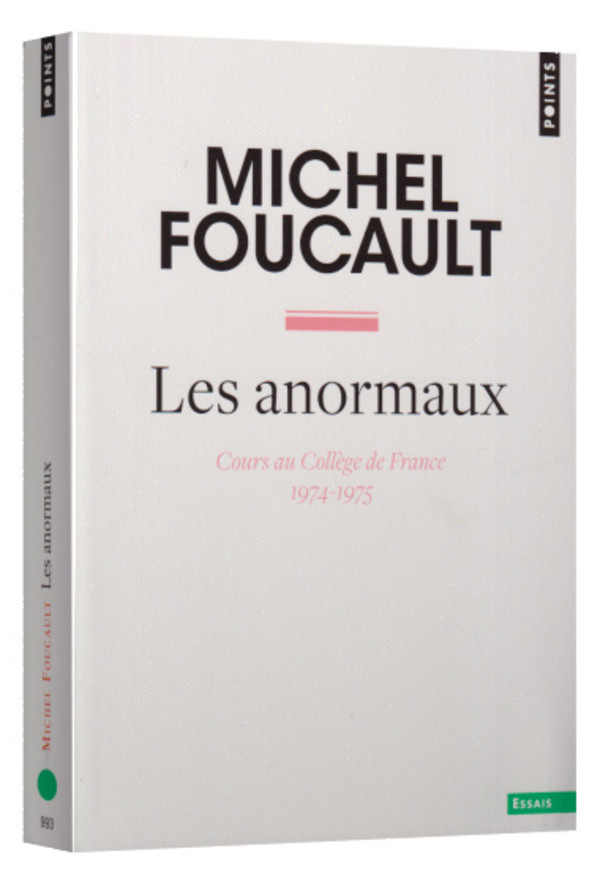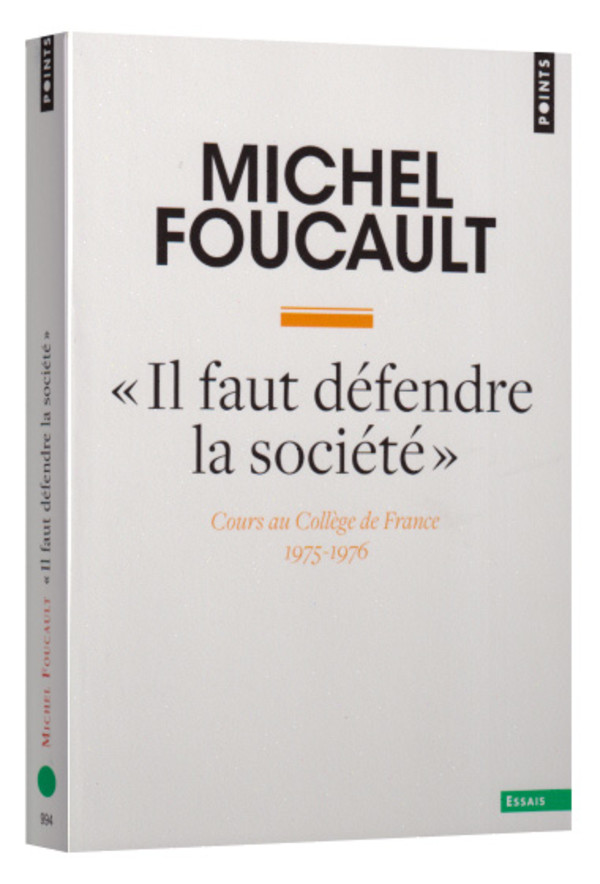Foucault et les métamorphoses de l’art de gouverner
04 octobre 2025
Entretien avec Jean-François Suratteau
À propos du livre Les métamorphoses de l’art de gouverner. Michel Foucault au Collège de France, Vrin - collection « Moments Philosophiques », septembre 2025
Vrin – Votre livre se compose de dix chapitres articulés autour de la notion pivot d’« art de gouverner ». Vous en étudiez les métamorphoses en analysant les leçons que prononce Foucault au Collège de France, où il a occupé la chaire « Histoire des systèmes de pensée » entre 1970 et 1984. L’art de gouverner désigne des pratiques du pouvoir au sein de l’État, mais aussi dans le monde judiciaire, médical, religieux… Pourquoi ce souci des formes multiples de l’art de gouverner ?
Le concept d’art de gouverner apparaît à un moment précis de l’enseignement de Foucault, au moment où sont en question la cohérence et l’articulation de pouvoirs multiples. Dès lors qu’il ne s’agit pas de placer des pouvoirs spécifiés par les modes et les lieux de leurs exercices sous un concept unitaire de pouvoir, comment penser l’agencement des pouvoirs à la fois selon leur simultanéité et leur succession ? L’art de gouverner répond à cette question, et l’examen lui confère un statut architectonique : les modifications de sa compréhension constituent le fil rouge rendant intelligible le passage de l’examen des relations de pouvoir à celui des actes par lesquels les sujets se prennent en vérité. Le statut architectonique conféré à l’art de gouverner marque, me semble-t-il, la spécificité de l’enseignement de Foucault au Collège de France, sans équivalent dans les ouvrages publiés. Remarquons qu’au moment de l’intervention du concept, Foucault se garde d’un examen en extension de la notion de gouvernement – quid du gouvernement d’une cité, d’une maison, des âmes… ? – pour donner un statut directement opératoire au concept, apte à prendre en charge la difficulté identifiée. Dans le cours prononcé à l’université de Sao Paulo en 1975, que les éditions Vrin ont publié sous le titre La généalogie du savoir moderne sur la sexualité, Foucault débute l’examen de l’aveu en « sensibilisant » les auditeurs à la nécessité de son interrogation par une considération en extension visant son « importance formidable » : l’aveu est partout, dans la pratique policière, dans la pratique judiciaire, dans les relations familiales, dans les rapports amoureux, dans la pédagogie, dans la médecine… Rien de tel au Collège de France pour l’art de gouverner : le concept vaut directement comme instrument d’analyse et, le cheminement le montrera, comme pièce maîtresse.
Vrin – Vous revendiquez dès les premières pages une méthode singulière, puisqu’il ne s’agit pas de brosser un portrait de l’auteur Foucault en restituant fidèlement le sujet de ses cours, ni de confronter vos analyses à ce que d’autres ont pu en dire : vous proposez de suivre sa pensée au travail, une pensée qui se déplace, dit Foucault lui-même, « comme l’écrevisse » (p. 8). En quoi cela consiste-t-il au juste ?
La lecture est un exercice qui n’est pas soumis à la contrainte de l’audition, dépendante de l’irréversibilité de l’émission du discours. Il est possible de reprendre les cours, et cette reprise peut suivre un autre ordre que celui de leur succession et se donner un temps qui lui est propre. La lecture est également un exercice en ce que, cherchant à s’approprier la conduite de l’examen, elle met à l’épreuve ce qui est soutenu en mettant le lecteur à l’épreuve, non seulement de sa compréhension, mais de son adoption. Un exercice par lequel le lecteur, distinct de l’auditeur, procède comme s’il était, non pas celui qui a dispensé l’enseignement, mais apte à être « avec lui » pour reprendre l’expression de Descartes s’agissant de la lecture des Méditations métaphysiques : « Je ne conseillerai jamais à personne de lire mon livre sinon à ceux qui pourront et voudront méditer sérieusement avec moi ». La méditation, pour être l’objet de la lecture, doit être un exercice pris en charge par le lecteur, appelé à méditer pour son compte. Lire les cours, c’est sans doute recevoir ce qui est soutenu – quitte à le refuser –, c’est aussi avoir l’ambition de conduire la lecture en adoptant pour son compte la conduite de l’examen – sauf à ne pas être à la hauteur de l’ambition. D’où la volonté d’être au plus près des cours au sens, non pas d’une réduction de la distance séparant le lecteur des objets considérés par l’enseignement, mais d’une activation par le commentaire du caractère opératoire de la démarche. D’où, pour suivre le fil de l’opérativité du cheminement, la volonté d’en appeler le moins possible aux livres publiés pendant la même période. Mais on ne s’interdit pas pour autant d’effectuer des « déplacements » – la convocation des sophistes, de Nietzsche ou d’Austin –, le lecteur reprenant en quelque sorte pour lui-même la figure de l’écrevisse (ou du crabe).
Vrin – Les cours de Michel Foucault étaient publics, comme le sont l’ensemble des cours au Collège de France. Ils étaient donc accessibles non seulement aux étudiants, comme ce fut votre cas, mais en principe à tout un chacun. Est-ce que cette dimension de publicité des textes prononcés influe sur le contenu théorique des cours, par rapports à d’autres dits et écrits de Foucault ?
Il me semble qu’il faut retenir le temps long de l’enseignement au Collège de France. La dimension de publicité des cours est marquée par le souci de Foucault de rappeler les exigences et les enjeux du parcours qui a été le sien lors de la reprise et de la poursuite de l’examen. Mais ce souci se manifeste surtout les dernières années et sa manifestation n’autorise pas à dire qu’il influence le contenu théorique. En revanche, si la continuation de l’enseignement n’implique ni l’identité des objets traités ni l’homogénéité de leur traitement, elle a partie liée avec la construction, qui donne aux moments successifs les places qui leur reviennent en fonction de l’avancée du travail. Ces moments ne sont pas comme les pièces d’un puzzle – parce que manque le tableau que révélerait l’assemblage de toutes les pièces –, ils ne sont pas non plus des pièces séparées comme le sont les livres qui, tout en pouvant être articulés, sont des touts autonomes. Remarquons que les livres succèdent aux cours qui traitent des mêmes objets – Surveiller et punir après La société punitive, La volonté de savoir après Les anormaux et « Il faut défendre la société » … Rapportés aux livres, les cours sont sans doute des esquisses. Considérés pour eux-mêmes, les cours sont des expérimentations qui manifestent ce qu’est une pensée en acte, un cheminement qui invente les points de repère en progressant et prend le risque de bifurcations et d’impasses. La salle de cours est un laboratoire dont les auditeurs sont partie prenante. L’enseignement est spécifique, moins par les thèses qu’il défend que par le travail des concepts et le mode de l’engagement théorique.
Vrin – L’œuvre de Foucault apparaît surtout analytique (analyser les rapports de pouvoir) et généalogique (remonter aux conditions de leur constitution), plutôt que normative. Pourtant, on peut lire, comme vous le montrez notamment dans le passage sur les cyniques (chapitre V), la défense d’une valeur pratique : actualiser « la résistance aux pouvoirs ». Y voyez-vous un appel à l’engagement politique ?
C’est une question importante. En quels termes envisager l’appel ? Que l’examen conduit par Foucault ait des présupposés et des implications politiques, la chose est certaine. Mais lorsqu’il substitue à une ambition prescriptive un « impératif conditionnel » – « si vous voulez lutter, voici quelques points clés, voici quelques lignes de force » –, Foucault entend fournir des éléments d’analyse sans préjuger des modes et des lieux de possibles interventions, sans préjuger non plus des volontés d’intervention. Sur le premier point, nous nous souvenons de l’image mobilisée ailleurs par Foucault : les examens sont « de petites boîtes à outils » dont les usages ne sont pas prédéfinis par celui qui les a élaborés (cf. Dits et écrits, Texte n° 151). Le second point est plus délicat. S’agit-il d’en appeler à résister aux pouvoirs ? Oui, sans doute. Mais quelle est la condition de la satisfaction de l’appel ? L’examen commandé par la problématisation de l’autoalèthurgie apporte un élément important. Dire que « l’élément premier et ultime de résistance au pouvoir politique est dans le rapport de soi à soi », c’est plus, pour reprendre en la détournant une expression de Paul Celan, « témoigner pour le témoin » qu’inviter quiconque à être un témoin : chacun est un sujet de résistance et le théoricien résiste pour son compte par les instruments qu’il met à la disposition de tiers. Il est vrai que l’articulation de l’interpellation cynique et de l’êthos de l’Aufklärung ne va pas de soi. Car nous pouvons comprendre que par la « vie autre » nous résistons au pouvoir politique en neutralisant les intérêts sur lesquels il se fixe pour investir d’autres intérêts, ou que l’investissement d’intérêts sur lesquels ne se fixe pas le pouvoir politique a une efficace sur son exercice et son maintien : nous détourner de la vie politique ou l’investir en fixant des exigences qui entravent ce qui nous est demandé par le pouvoir politique ?
Propos recueillis par Émilie Brusson le 2 octobre 2025