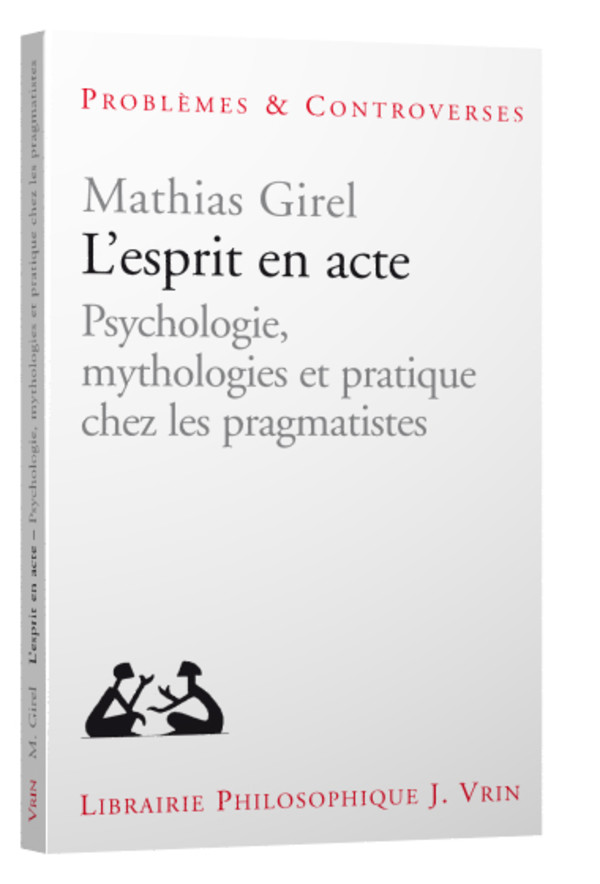Entretien avec Mathias Girel autour de son livre L’esprit en acte
03 janvier 2022
Mathias Girel, vous réunissez dans votre ouvrage L’esprit en acte plusieurs études faisant dialoguer les auteurs majeurs du pragmatisme, une école philosophique américaine née à la fin du XIXe siècle. Vous identifiez comme thèse centrale unissant ces auteurs le lien organique qu’ils établissent entre l’esprit et l’action : en quoi cela définit-il la pensée pragmatiste ?
Ce n’est pas la seule thèse, comme je l’explique dans le livre, car il faut a minima la compléter d’une thèse épistémologique et d’une thèse sémantique, et peut-être d’autres convictions d’arrière-plan, telle que l’importance de penser philosophiquement les effets du darwinisme, ou encore une attention à la continuité ainsi qu’au devenir. Cependant, l’idée de considérer les croyances, et plus généralement les produits de l’esprit, comme des dispositions, est en effet typique de ce mouvement. On a ainsi longtemps affirmé que les pragmatistes avaient appliqué en philosophie les idées du psychologue écossais Alexander Bain, qui faisait des croyances des « préparations à agir », mais je tente de montrer que l’histoire est plus compliquée, ne serait-ce que parce que l’on peut comprendre cette idée soit comme une thèse forte — nos croyances sont l’aspect mental de nos habitudes — soit en un sens plus faible, comme lorsque l’on pense que nos croyances peuvent, sous la condition de désirs, expliquer nos actions. Il reste que cette thèse, que j’appelle dans le livre « thèse médiane », peut servir à articuler la thèse épistémologique, qui considère l’enquête comme une stabilisation de croyances, et la thèse méthodologique ou sémantique, qui prétend éclairer nos conceptions abstraites par l’examen de leurs incidences pratiques. Si nos croyances sont des habitudes, elles possèdent sans doute à ce titre la stabilité qui est recherchée par la thèse épistémologique ; si ces habitudes s’expriment par des séries d’actions, elles se caractérisent bien par les effets pratiques qui intéressent la thèse sémantique.
Vous dites qu’on a longtemps gardé l'image du pragmatisme comme d’un mouvement « pour hommes d’affaires pressés » (p. 14). Comment comprendre ce préjugé tenace ?
Russell n’y est pas pour rien, de même que certaines formulations des pragmatistes eux-mêmes, lorsque James par exemple parle de la « valeur au comptant », cash value, de nos conceptions. Dewey a répondu par la dérision, en disant que le pragmatisme était aussi peu une expression de la tendance affairiste, censée caractériser l’esprit américain, que le goût allemand pour la synthèse une expression de la tendance à accompagner de bière la choucroute et les saucisses… On peut trouver que c’est une réponse un peu triviale, mais elle ne l’est sans doute pas davantage que l’accusation à laquelle elle répond. Enfermer la philosophie américaine dans l’image que l’on s’en fait est antérieur au pragmatisme : Tocqueville va jusqu’à attribuer aux Américains du XIXe siècle une attitude « cartésienne », centrée sur la raison individuelle, et affirmer qu’ils ne connaissant pas même les noms des philosophes européens, au moment même où Emerson et Thoreau écrivent leurs premiers textes fondateurs. Il suffit d’ailleurs de lire les pragmatistes pour dissiper la caricature que vous évoquez : le jeune Peirce est plongé dans les épais folios des scolastiques, James écrit les quinze-cents pages des Principles pour traquer les problèmes de philosophie de l’esprit, Dewey formule une philosophie de la démocratie extrêmement critique de la société dans laquelle il vit.
Quelles autres « mythologies » entourant le mouvement pragmatiste dénoncez-vous dans ce livre ?
Il y a tout d’abord, chez James en particulier, une critique philosophique des mythologies psychologiques, au sens des fictions que l’on retrouve sans cesse en philosophie de l’esprit. C’est pour cela qu’il me semblait nécessaire de critiquer le mythe d’un James « passant » de la psychologie à la philosophie, idée reçue qui est parfois même celle de ses amis, Bergson par exemple. Un autre « mythe » tient à l’opposition frontale entre Peirce et James : ils ont des différends profonds, mais ils ne se situent pas forcément dans l’opposition entre un pragmatisme scientifique, celui de Peirce, et un pragmatisme plus « littéraire », celui de James. Enfin, on leur prête un simple renversement de la philosophie abstraite, où la référence à la pratique serait censée régler tous les problèmes...
Justement, vous dites qu’il semble que « le concept de pratique soit le plus fuyant de toute la controverse sur le pragmatisme » (p. 163). Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
Je veux dire par là que, même s’il y a chez eux une attention aux « effets pratiques », il n’est pas certain que les pragmatistes comprennent cette pratique de la même manière, et que cela est primordial si l’on veut à la fois identifier leurs points communs mais aussi leurs différences. Pour le comprendre, il faut dépasser les slogans pour regarder de près ce que font les textes. Certes, il y a chez Peirce, James et Dewey la conviction que la philosophie ne peut pas, comme cela a souvent été le cas, « gommer » le fait que nous sommes des agents, que nous agissons. James entendra dès le départ rompre avec l’idée de l’agent connaissant comme simple spectateur, Dewey, dès le « Concept d’arc réflexe » (1896) souhaite aussi rompre avec cette idée, et il ne cessera de l’approfondir, jusqu’à sa Logique de 1938. Mais dire cela, ce n’est pas avoir apporté une solution, c’est avoir posé un problème : comment au juste décrire la pratique ? Quelle grammaire mobiliser ? Y a-t-il une dimension pratique jusque dans nos opérations les plus abstraites, en mathématiques par exemple ? Il y a là un immense chantier philosophique qui, si je ne me trompe pas, occupe les pragmatistes dans la période qui sépare leurs premiers écrits du grand débat sur le pragmatisme, qui occupe au moins les dix premières années du XXe siècle.
Propos recueillis par Émilie Brusson