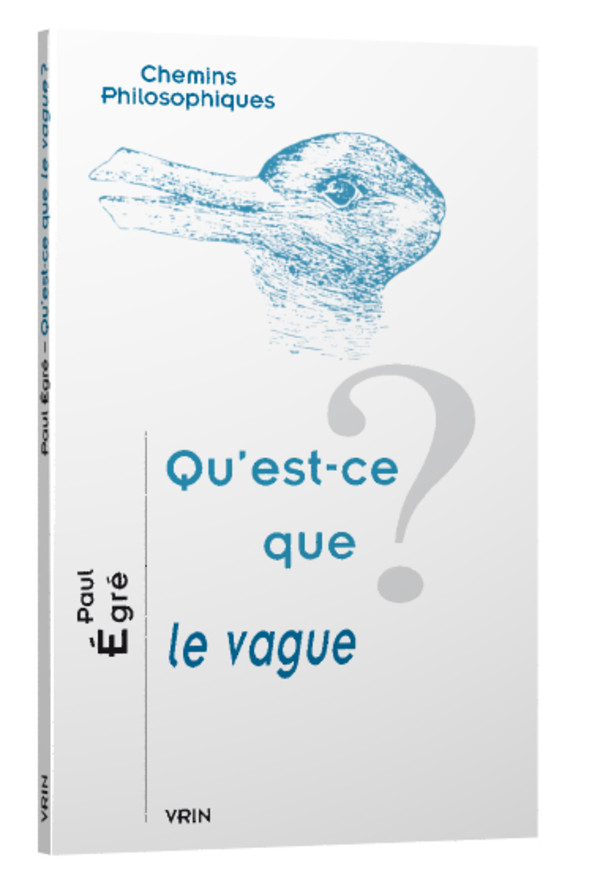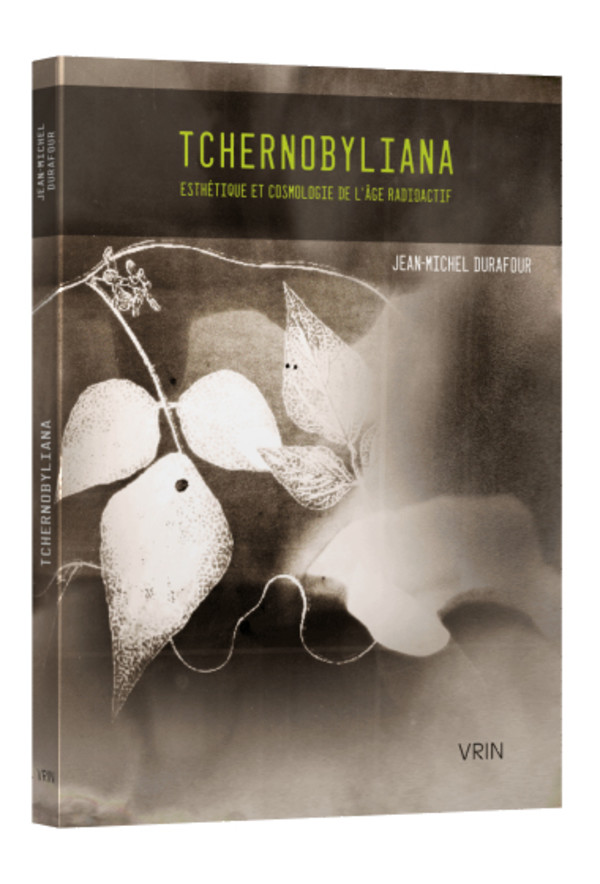Entretien avec Jean-Michel Durafour autour de son livre "Tchernobyliana. Esthétique et cosmologie de l'âge radioactif"
04 juillet 2021
Jean-Michel Durafour est agrégé de philosophie, poète, Professeur des universités en esthétique et théorie du cinéma à l’université Aix-Marseille.
Vous écrivez dans les premières pages de votre livre que vous vous proposez de penser une esthétique « radieuse » de la radioactivité. Comment peut-on penser de façon optimiste l’âge radioactif ?
Ouvrez n’importe quel journal, allumez la radio, la télévision à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit : vous tomberez inévitablement sur des articles ou des nouvelles inquiétantes sur l’état de la planète, la pollution des eaux, les mégafeux de forêts, la déforestation galopante, l’extinction programmée de nombreuses espèces animales. Et ces nouvelles – plus ou moins bien renseignées – ne font pas que nous alerter, elles nous alarment. Latour a raison de dire dans Face à Gaïa que « l’écologie rend fou ». Certes, il n’y a pas de quoi se réjouir ni même tout simplement vaquer à nos anciennes occupations comme si de rien n’était ; mais le monde comme il va et de nombreux discours qui l’accompagnent ne cessent de générer depuis quelques années de plus en plus d’éco-anxiété (ou solastalgie, comme on l’appelle également). Et en effet, nous avons objectivement un problème. Nous aurions pu agir, nous l’aurions dû, nous sommes coupables et misérables de ne pas l’avoir su à temps. Nous payons le prix maximal pour notre insouciance, en entraînant le reste de la création dans notre effondrement. Évidemment, comme dans tout affect triste, il y a quelques bons côtés à la chose (comme l’intérêt que nous semblons enfin porter à la biodiversité) ; mais globalement nous sommes entrés dans un profond désespoir affermi par le sentiment rétrospectif d’avoir laissé passer notre chance d’inverser le destin. Bref, nous ne sommes plus que devant un avenir bouché, tracé d’avance, un avenir conjugué au passé, comme si nous commencions par nous placer d’emblée en situation de fin du monde. C’est par une contestation de cette logique de la fin du monde que s’ouvre mon essai.
Je propose au contraire de retrouver la voie de l’optimisme. Voilà un mot qui sonne bien curieusement dans l’époque ! Et l’on pourrait me dire : mais que de désinvolture, que d’aveuglement ! Eh bien, je crois que c’est exactement le contraire, en réalité. Il ne s’agit certainement pas de se jeter à corps perdu dans ce que Jean-Baptiste Fressoz a nommé « l’apocalypse joyeuse ». Cela va de soi. Mais d’expérience nous savons toutes et tous que la peur ou le désespoir sont de très mauvais conseillers et n’aident guère à penser ce qui doit l’être. Quand Latour écrit, dans son dernier ouvrage, que nous devons apprendre à nous « égailler » avec les vivants dans toutes les directions en quittant notre position anthropocentrée (Où suis-je ?), il dit aussi implicitement que nous devons nous « égayer ». Il faut réapprendre à être gai. Cette leçon, je la tiens avant tout de Michel Serres, qui n’a rien du naïf ou du béat dans lequel on le caricature trop souvent parce que nous n’arrivons plus à le comprendre. Il faut continuer de croire dans l’être humain. Comment ? Pourquoi ? C’est à nous de l’inventer.
C’est ainsi que je propose d’appréhender l’explosion nucléaire du quatrième réacteur de la centrale de Tchernobyl, la catastrophe terrible qui s’en est suivie (humaine, environnementale) et les arts qui s’en sont emparés. Tous les gestes artistiques dont je parle ont pour particularité de travailler directement avec des matériaux ou des êtres irradiés. C’est parfois très dangereux, ou du moins ça n’est jamais très rassurant. Et pourtant ces œuvres, très différentes les unes des autres, nous montrent que les choses ne sont pas simples. Bien sûr, il y a eu des conséquences tragiques, abominables, tant sur le plan médical que sur le plan écologique, mais le vivant – plutôt que la vie dont on ne sait pas bien ce que c’est – trouve toujours son chemin (comme le retour d’espèces animales disparues dans la « zone d’exclusion » abandonnée par les communautés humaines). L’art, qui dénonce mais qui est aussi une fête (Nietzsche), doit jouer ici un rôle décisif pour nous révéler ce qu’il peut y avoir de « radieux » dans l’âge radioactif, et qui ne veut donc certainement pas dire que nous devons nous jeter le sourire aux lèvres dans la radioactivité de masse, cela va sans dire, ni même dans le choix énergétique du nucléaire (je ne crois pas que l’on pourrait deviner, en me lisant, ce que j’en pense à titre personnel), mais que l’art – sans revenir au vers constamment cité d’Hölderlin sur le danger et ce qui sauve du danger – va dans le sens de la vie.
Au travers du dessin, de la photographie, du cinéma, vous nous montrez des exemples de mutations environnementales qui ont suivi la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Or, ces mutations ne sont pas spectaculaires : on est loin des zombis et autres monstres présentés dans les films et ouvrages d’anticipation. Est-ce pour cela que vous affirmez que « la radioactivité est moins, pour l’art un objet de représentation qu’une manière de regarder » ? Vous parlez également d’images qui nous laisseraient « sans voir » : comme s’il n’y avait rien à voir à Tchernobyl. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
Oui, tout à fait. La radioactivité en question ici n’est pas un spectacle. Je ne vois rien à Tchernobyl (pour pasticher une formule fameuse de Marguerite Duras) ou pas grand-chose : des insectes difformes, des plantes à l’aspect tout ce qu’il y a de plus normal, de la pellicule un peu abîmée. Toutes choses justement si peu marquantes qu’elles peuvent très facilement intégrer la liste des faits, ou plutôt des non-faits, avec lesquels on n’a pas manqué de contester, au lieu de constater, qu’il se soit passé quoi que ce soit de terrifiant avec l’incident de Tchernobyl. Pour le dire en un mot : il n’y a pas de Godzilla de Tchernobyl. Et puis, à la rigueur, même en accordant qu’il y aurait quoi que ce soit d’un peu déroutant dans ces spécimens que le dessin ou la photographie nous révèlent, ce ne sont jamais que des malformations de pattes de punaises ou des espèces curieusement bien portantes (ce qui est un comble !) : bref, cela ne nous regarde pas. Voilà ce qu’on pourrait dire si l’on était, par exemple, dans le camp des défenseurs ravis du nucléaire, ou tout simplement des indifférents.
Or il s’est bien passé quelque chose à Tchernobyl. En fait, il faut changer de paradigme – et c’est là l’un des enjeux conceptuels centraux de mon essai. Il y a, à mon sens, deux imageries très différentes selon que l’on a affaire au nucléaire (civil) ou atomique (militaire). Dans le cas de la bombe atomique, on retrouve la pyrotechnie de l’apocalypse à laquelle le cinéma hollywoodien, par exemple, nous a par la suite acclimatés. L’étoile Absinthe s’écrase sur Terre dans le texte de Jean (notons qu’ironiquement Tchernobyl vient du mot russe qui désigne l’absinthe…), dont Deleuze a rappelé qu’il était le « premier livre à grand spectacle » de l’humanité (Critique et clinique). La destruction tombe du ciel. Dans le cas des bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki, elle a même eu lieu dans le ciel puisqu’elles ont explosé à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. On est dans le prolongement de la représentation traditionnelle de la punition divine. C’est ce que j’appelle des images ex-orbitantes : par leur excès, leur démesure, elles font sortir les yeux de la tête. Elles en mettent plein la vue. Il en va différemment avec le nucléaire de Tchernobyl. Il relève de ce que j’ai nommé l’in-oculation. Le regard n’est plus jeté hors des yeux mais il y a une injection lente et imperceptible des yeux dans les choses. À Tchernobyl, la menace n’est plus céleste ni divine, mais elle est infernale et souterraine. Et donc le visible n’est plus tout à fait son critère d’appréciation.
Et de là, effectivement, comme vous le rappelez, la radioactivité à Tchernobyl, la radioactivité dont Tchernobyl fournit ici le cadre paradigmatique, est moins un objet de représentation qu’une manière de regarder. C’est cela l’in-oculation. Il faut regarder non pas ce qui est irradié, mais selon ce qui est irradié et essayer de voir de l’intérieur. C’est ce qui est commun aux travaux d’Anaïs Tondeur, de Susan Schluppi ou de Cornelia Hesse-Honegger dont je parle dans le livre. C’est ainsi toute une esthétique classique de la relation sujet/objet que l’art de Tchernobyl nous invite à dépasser par ce que je propose de baptiser une révolution dysonienne de l’esthétique. Une sphère de Dyson est une mégastructure d’astro-ingénierie hypothétique décrite en 1960 par le physicien Freeman J. Dyson consistant en un globe creux situé autour d’une étoile. Dans le cycle de science-fiction Omale, Laurent Genefort a imaginé un monde dysonien dont les habitants vivent sur la surface interne, dans un jour permanent : le soleil est désormais au centre de la planète. J’en retiens l’idée d’un bouleversement astronomique, c’est-à-dire dans notre manière de penser.
L’astronomie permet de dégager une histoire de la philosophie occidentale de l’art en trois temps. Je vais un peu vite. Premièrement : une philosophie tournée vers l’objet. Le monde existe indépendamment d’un sujet (dont l’intériorité n’est jamais un objet d’étude pour elle-même). C’est le cosmos antique : nous sommes au centre de l’univers, l’univers n’a pas besoin de nous pour tourner et la perfection de la vie consiste à se rendre semblable aux astres qui le peuplent. Il n’y a pas encore d’esthétique et l’art tient sa valeur de sa proximité ou de son éloignement avec la vérité, c’est une affaire de connaissance. Deuxièmement : la philosophie moderne tournée vers le sujet (née avec Descartes et dont Kant est le couronnement avec la « révolution copernicienne »), retourne la donne : c’est le moment de la naissance graduelle de l’esthétique, qui ne devient plus qu’une affaire de jugement et ne nous apprend rien sur quoi que ce soit mais n’informe que sur l’état de plaisir ou de déplaisir du sujet qui pense. Troisièmement, une philosophie tournée vers le trajet, relationnelle et refusant la disjonction entre le sujet et l’objet (chez Berque ou chez Latour par exemple – avec partout de nombreux emprunts à des formes de pensées non occidentales : japonaise, amérindienne, etc.). Il s’agit dorénavant de quitter la Terre (pour mieux être sur terre), d’aller de l’autre côté du soleil. Et qu’y trouve-t-on ? Que trouve-t-on de l’autre côté de l’objet, quand on va au-delà des réalités astronomiques extérieures (le regard déterrestré de l’astronomie) ? On trouve la face interne du sujet. C’est en cela que l’esthétique dont je parle est « radieuse », pour en revenir à votre première question : parce qu’elle réduit notre rayon de vie. L’art de Tchernobyl nous invite à ne regarder qu’autour de nous et à affirmer notre appartenance aux êtres minuscules du monde. Il bouscule toutes les habitudes de notre regard explorateur et colonisateur – de là aussi le rôle majeur qu’y tiennent de nombreuses femmes. L’accident de Tchernobyl nous rappelle que nous ne vivons pas sur une « bille bleue » perdue dans l’espace, vue depuis un nulle-part extra-terrestre (qui nous a fait sortir d’un monde dans lequel notre conscience nous avait déjà de plus en plus isolés), mais dans des réseaux mutualistes et de coparticipation dans lesquels – pour reprendre une belle formule de Anna Lowenhaupt Tsing – il n’y a que « des agencements ouverts de modes de vie entremêlés de telle manière qu’ils forment des coalitions coordonnées entre des rythmes temporels extrêmement divers » (Le Champignon de la fin du monde). C’est à ce titre que je m’intéresse au temps de l’art et de ce qu’il fait avec les durées des insectes ou des plants de lin.
Vous appelez, dans l’esthétique que vous développez dans votre livre, à décentrer le regard du sujet humain, et vous privilégiez dans vos analyses le sujet animal ou végétal. Pourtant Tchernobyl est souvent pensée de prime abord comme une catastrophe humaine. Pourquoi avoir choisi un tel décentrement ?
L’esthétique du nucléaire exige un regard énucléé. Là où le spectacle atomique nous laisse sans voix (et au contraire attise notre regard), le non-spectacle nucléaire nous laisse « sans voir » – vous le rappelez avec raison. Il nous apprend à quitter l’être humain qui se tient debout dans notre regard. De cela, il faut parler.
La distinction entre l’être humain et les animaux, c’est l’un des points que je rappelle dans l’essai, ne tombe pas entre l’humain et l’animal, mais tombe dans ce qui est humain et dans ce qui est non humain. Il est évident, d’une part, que les humains ont une part animale, au moins anatomique mais pas seulement : comme le dit avec humour Gabriel Tarde, il est parfois plus judicieux pour comprendre la réaction des Français ou des Allemands de passer par le fait que ce sont d’abord des mammifères. Mais, d’autre part, il n’existe pas non plus de nature qui ne serait pas à un degré ou un autre anthropisée. Baptiste Morizot (Les Diplomates) a bien redit combien le loup, par exemple, archétype dans l’imaginaire collectif de l’animal sauvage qui vient mettre la pagaille dans ce que les humains élaborent et avec lequel les éleveurs sont historiquement en compétition trophique sur les mêmes territoires, est une invention dans ses comportements « sanguinaires » de l’agropastoralisme. En sélectionnant des animaux grégaires, comme les brebis, pour faciliter les travaux de l’élevage ou du pacage, les hommes ont créé le loup qui tue plus qu’il ne consomme, car c’est un animal qui n’arrête sa prédation que lorsque ses victimes se dispersent. C’est la logique du troupeau domestiqué qui invente le loup tel que nous le craignions à tort. À quoi sont venus s’ajouter en Europe le travail des enfants, les cadavres laissés à l’abandon sur les champs de bataille, l’éco-fragmentation qui a réduit les proies. Et nous voilà avec le loup assassin et mangeur d’hommes du Petit Chaperon rouge ou de la Bête du Gévaudan ! Nous devons au contraire apprendre à « penser avec une tête de loup ». De proche en proche, cela est vrai de tout le maillage faussement appelé « naturel », par opposition traditionnelle à la culture. Même la forêt vierge – son cas a été étudié par Viveiros de Castro – est une fiction qui n’a rien de « vierge » : elle est le produit millénaire de sélection de plantes par les peuples amérindiens ou de prolifération d’autres végétaux dans les marges non occupées par l’homme. Jusqu’où faudrait-il remonter pour nous représenter une nature sans hommes : cette question n’a aucun sens, car à tout le moins, si l’homme n’est pas dans l’image, ce ne peut-être que lui qui pose la question. La nature est toujours l’autre de la culture, répondant au bon vieil adage que l’herbe est toujours plus verte de l’autre côté.
C’est donc un décentrement qui est un recentrement. Pour moi, Tchernobyl est une catastrophe du vivant. En ce sens, elle sert de focus – c’est la dernière partie du livre – à une autre politique du vivant. Car l’esthétique, comme n’a cessé de le dire Rancière, opère une partition du sensible sur laquelle le politique va venir ensuite opérer. C’est ce que j’appelle à propos de l’événement-Tchernobyl la « fission du sensible » : là où le « partage » (Rancière) multiplie les parts plus petites, la fission est une division qui fend (findere). La fission nucléaire est une fissure du sens. En ce sens, Michael Marder a raison de voir dans Tchernobyl un tournant métaphysique. Politiquement parlant, cette fission implique de repenser le contrat qui nous lie au reste du vivant à partir d’un déplacement de la logique de la communauté vers celle de la collectivité. Il ne s’agit plus seulement d’intégrer le vivant dans notre droit, de lui laisser une place, mais d’élaborer de nouveaux contrats avec le vivant. C’est la nature de ces contrats que j’aborde à la fin de mon essai.
La catastrophe de Tchernobyl concentre un haut degré de criticité. On appelle « accident de criticité » – c’est ce qui s’est passé le 26 avril 1986 – une réaction nucléaire en chaîne incontrôlée dans un combustible fissible. Une réaction en chaîne dans notre « logique du sens » : c’est ce à quoi nous invite les arts de Tchernobyl. Ils mettent en œuvre d’une manière non discursive et non théorique une criticité de la faculté de juger. Rien de plus et rien de moins.
Propos recueillis par Émilie Brusson